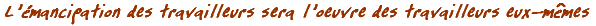Dossier La Commune de Paris 150e anniversaire
Notre journal La Commune propose à ses lecteurs deux dossiers consacrés au 150e anniversaire de la Commune de Paris : le premier, dans le numéro 127, retrace, à la lecture de La Guerre civile en France, 1871 : La Commune de Paris, de Karl Marx, les causes de la Commune de Paris, sur un temps long (les 80 ans qui la séparent de la Révolution française) et un temps court (la guerre franco-prussienne et le siège de Paris) ; ce dossier essaie de faire revivre la première journée des 72 jours d'existence de la Commune de Paris, le 18 mars 1871 ; le deuxième dossier, dans le numéro 128, traitera, entre autres, de l'internationalisme de la Commune à travers le portrait de ses militants étrangers.

I. Les causes profondes de la Commune de Paris : la bourgeoisie contre la révolution
« Après chaque révolution, qui marquait une phase plus avancée dans la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État ressortait avec un relief de plus en plus impudent »1
La Commune de Paris, c'est la dernière révolution du XIXe siècle ; c'est aussi, lors de la Semaine sanglante, le dernier assaut mené par la bourgeoisie contre le prolétariat au XIXe siècle, le dernier assaut d'une longue série depuis la révolution de 1789, un des plus sanglants aussi.
Tout au long du XVIIIe siècle, la classe bourgeoise travaille à disposer pleinement et, pour ses seuls intérêts, de l'appareil d'État mis en place pendant la monarchie absolue, en bref à s'emparer du pouvoir politique. La révolution de 1789 est pour la bourgeoisie le moment clé où elle en prend possession et le ravit à l'aristocratie et au clergé ; cette bourgeoisie royaliste n'a pas encore besoin de la République pour mener ses affaires ; le 17 juillet 1791, au Champ de Mars, elle fait massacrer le peuple qui pétitionne pour la déchéance royale et pour la proclamation de la République ; après la prise du Palais des Tuileries le 10 août 1792 par les sans-culottes et la promulgation de la Commune insurrectionnelle, la bourgeoisie est contrainte à l'abolition de la royauté mais va désormais utiliser tous les moyens pour venir à bout du prolétariat et le cadenasser lors de la réaction thermidorienne (chute de Robespierre, le 9 Thermidor an II), du Directoire et de l'Empire.
Mise à l'écart par l'aristocratie de retour au pouvoir pendant la Restauration, la bourgeoisie, Adolphe Thiers à sa tête, est à la manœuvre pendant la révolution de 1830 : comme l'explique Karl Marx, « la révolution de 1830, qui aboutit à un transfert de gouvernement des propriétaires terriens aux capitalistes, le transféra des antagonistes les plus éloignés des ouvriers à leurs antagonistes les plus directs »1 ; avec Louis-Philippe, les banquiers reviennent sur le devant de la scène et dirigent le gouvernement : l'exploitation industrielle de la classe ouvrière, de ses enfants à l'usine connaît un essor ininterrompu pendant cette première moitié du XIXe siècle. La lutte des classes s'exacerbe jusqu'en 1848 (notamment en 1834 à Lyon, avec la révolte des canuts mais aussi dans tous les grands centres urbains et industriels où les ouvriers luttent pour leur survie et leurs droits).
En février 1848, le prolétariat est en armes dans les rues de Paris ; la seconde République est promulguée ; quatre mois plus tard, en juin, la révolution est réprimée dans le sang : « Les bourgeois républicains qui, au nom de la révolution de Février, s'emparèrent du pouvoir d'État, le firent servir aux massacres de Juin, afin de convaincre la classe ouvrière que la République « sociale » cela signifiait la République qui assurait leur sujétion sociale, et afin de convaincre la masse royaliste de la classe bourgeoise et terrienne qu'ils pouvaient en toute sécurité abandonner leurs soucis et les émoluments du gouvernement aux « républicains » bourgeois »1.
Face à la menace du prolétariat et à la lutte des classes, la République, avec Louis Bonaparte comme président, est momentanément le régime qui permet à toutes les classes dirigeantes de s'entendre, aristocrates comme bourgeois : « Les entraves, que sous les régimes précédents leurs propres divisions avaient encore mises au pouvoir d'État, furent écartées par leur union ; et en vue du soulèvement du prolétariat qui menaçait, ils se servirent alors de ce pouvoir d’État sans merci, avec ostentation, comme l'engin de guerre national du Capital contre le Travail »1. L'Empire, suite au coup d’État du 2 décembre 1851, devint alors pour cette bourgeoisie la forme de gouvernement utile pour développer la banque, le commerce et l'industrie tout en réprimant les masses productives. Si la bourgeoisie est obligée pour cela de renoncer à ses pouvoirs parlementaires, elle concentre pouvoirs économiques et politiques comme jamais : en 1867, Eugène Schneider, maître des forges du Creusot, président du Comité des Forges, régent de la Banque de France, administrateur de la Société Générale, est aussi maire du Creusot, président du Conseil Général de Saône-et-Loire et … président du Corps législatif !
Opprimées, les masses productives n'en rabattent pourtant pas : les grèves se multiplient (en 1864, Napoléon III a dû autoriser les coalitions ouvrières) ; les travailleurs s'organisent (en 1864, l'Association Internationale des Travailleurs est créée à Londres). Réprimée férocement en juin 1848, la classe ouvrière ne désarme pas et s'oppose à l'Empire.
C'est dans ce contexte que, soucieux de sauver l'Empire et d'assurer sa longévité dynastique, alors que le prolétariat se dresse chaque jour plus fort contre le pouvoir (comme lors des funérailles de Victor Noir en janvier 1870), que la grève sévit au Creusot de janvier à avril 1870, Napoléon III recourt une nouvelle fois au plébiscite. Si le « Oui » l'emporte, la France industrielle de l'Est, la France des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, où vivent les ouvriers, exprime fortement son opposition à l'Empire.
« Le complot de guerre de juillet 1870 n'est qu'une édition amendée du coup d'État de décembre 1851. »1
La guerre contre la Prusse est alors imaginée par Napoléon III et son gouvernement comme la meilleure réponse pour restaurer l'ordre et accroître la grandeur de l'Empire : une guerre extérieure pour résoudre des problèmes intérieurs. Depuis sa naissance, le Second Empire revendiquait le retour aux frontières du premier Empire : en particulier la rive gauche du Rhin était particulièrement convoitée. Lors de la guerre austro-prussienne de 1866, en échange de la neutralité de l'Empire français, Bismarck avait promis des compensations territoriales avant de revenir sur sa parole. Sous un prétexte diplomatique mineur (la candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne), le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse.
II. Les causes immédiates de la Commune : la guerre franco-prussienne et le siège de Paris
Dès début août 1870, l'Empire français essuie revers sur revers à Wissembourg, Froeschwiller et Forbach. Parallèlement, l'effervescence révolutionnaire s'est accrue avec l'entrée en guerre : en août 1870, les manifestations au Creusot, contre la guerre à Paris, les tentatives d'instauration d'une Commune à Marseille, à Lyon témoignent du climat insurrectionnel dans les centres industriels et les grandes villes.
A l'annonce de la défaite de l'armée française et de l'emprisonnement de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870, la révolution se met en marche dans les grandes villes qui proclament simultanément la République, à Paris, Marseille et Lyon.
A Paris, le 4 septembre 1870, les manifestants envahissent l'Assemblée nationale. Aussitôt les députés républicains de Paris se précipitent à l'Hôtel-de-Ville et se déclarent gouvernement provisoire afin de limiter les velléités des manifestants des faubourgs, des militants de l'Internationale, des socialistes. Ces députés, au nom de la République et de la lutte contre l'ennemi prussien en marche sur Paris, forment alors un gouvernement de Défense nationale présidé par le général Trochu. Ce gouvernement des Jules (Simon, Favre, Ferry, Trochu), assisté par un Adolphe Thiers envoyé spécial dans les cours d'Europe pour demander leur médiation, fait en réalité semblant de combattre la Prusse et passe son temps à négocier la reddition avec Bismarck (dès le 19 septembre 1870, Favre rencontre Bismarck au château de Ferrières) pour mieux écraser la classe ouvrière qui se dresse.
La ville de Paris, où la révolution avait commencé, est le lieu où va se cristalliser la guerre civile entre la bourgeoisie et le prolétariat. A partir du 19 septembre 1870, Paris est encerclée par les armées prussiennes. Le premier siège de Paris commence et dure 4 mois dans des conditions terribles de froid, de famine et de bombardements. Pour se défendre, le peuple se mobilise et s'arme : des 24 000 gardes nationaux, l'on passe à 300 000 pendant le siège, en plus de l'armée de métier. Des canons pour défendre Paris sont achetés par souscription de la population.
« Mais Paris armé était la révolution armée. Une victoire de Paris sur l'agresseur prussien aurait été une victoire de l'ouvrier français sur la capitaliste français et ses parasites d'État. Dans ce conflit entre le devoir national et l'intérêt de classe , le gouvernement de la Défense nationale n'hésita pas un instant à se changer en un gouvernement de la Défection nationale. »1
Les capitulations de l'armée, dirigées par des généraux royalistes se multiplient : Toul, Strasbourg, Orléans, Soissons, Metz … tandis que le prolétariat des grandes villes, à Paris, Lyon, Marseille essaie de reprendre le pouvoir (le 31 octobre 1870, l'Hôtel-de-Ville est occupé par la classe ouvrière en colère).
Le gouvernement joue la farce de la Défense nationale jusqu'au 28 janvier 1871 où les masques tombent : le gouvernement signe l'armistice avec la Prusse, accepte de perdre l'Alsace et la Lorraine contre l'assurance de pouvoir faire marcher ses armées sur les insurgés parisiens ! Le peuple de Paris qui avait tellement souffert du siège mesure la trahison du gouvernement de Défense nationale. L’armistice stipule que des élections législatives doivent avoir lieu dans les trois semaines et que l'Assemblée élue ratifiera alors la paix : le 8 février 1871, c'est une assemblée majoritairement royaliste et réactionnaire qui est élue, prête à toutes les compromissions pour le retour de l'ordre.
Thiers est élu le 17 février 1871 « chef du pouvoir exécutif » par l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux. Dès lors, il multiplie les mesures pour décapiter le prolétariat parisien : menace de suppression de la solde des gardes nationaux ; paiement immédiat des arriérés de loyers et des effets de commerce ; décapitalisation de Paris au profit de Versailles ; nomination d'ambassadeurs orléanistes ; sentences de mort contre Blanqui et Flourens, chefs de l'insurrection ; interdiction des journaux « rouges » parisiens ...
Et pour finir il décide de désarmer Paris en saisissant les canons que le peuple a lui-même contribué à payer par souscription. C'est l'ultime trahison …
III. Le 18 mars 1871
C'est le premier des 72 jours d'existence de la Commune de Paris. La veille, la nuit du 17 au 18 mars 1871, le conseil des ministres, présidé par le chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, décide la saisie des canons regroupés à Montmartre, Belleville et autres lieux de Paris que la Garde nationale a déménagés le 26 février 1871 pour les mettre hors d'atteinte lors de l'entrée des Prussiens à Paris début mars. Le conseil des ministres prévoit également l'arrestation des principaux meneurs révolutionnaires et le quadrillage militaire de Paris.
Mais le 18 mars 1871, rien ne se passe comme l'avait imaginé le gouvernement : si, à trois heures du matin, à peine une heure après la fin du conseil des ministres, les troupes investissent bien les différents quartiers de Paris, l'enlèvement des canons s'avère plus compliqué que prévu, faute d'attelages ; et surtout, les quartiers populaires de Montmartre et de Belleville se réveillent et empêchent la saisie des canons ; refusant d’obéir aux ordres des officiers de tirer sur la foule présente, les troupes fraternisent avec le peuple. Face à la contre-offensive des gardes nationaux, Thiers et son gouvernement s'enfuient et gagnent Versailles dans l'après-midi. A minuit, le Comité central de la Garde nationale prend possession de l'Hôtel-de-Ville.
Afin de décrire l'ambiance de cette première journée de la Commune de Paris, il nous a semblé intéressant de donner la parole à deux femmes qui y ont participé, l'une très célèbre, institutrice, militante féministe, Louise Michel, l'autre ambulancière, cantinière et infirmière, Victorine Malenfant, toutes deux combattantes sur les barricades et à l'un des journalistes qui a chroniqué au jour le jour la Commune, Prosper-Olivier Lissagaray,
La nuit du 17 au 18 mars 1871, Louise Michel (29 mai 1830-9 janvier 1905), membre des deux comités de vigilance, celui des femmes et celui des hommes, du XVIIIe arrondissement, où elle travaille comme institutrice, est sur la Butte au poste de la Garde nationale, au n°6 de la rue des Rosiers et voit tomber le factionnaire Turpin2.
« Je descends la butte, ma carabine sous mon manteau, en criant : Trahison ! Une colonne se formait, tout le comité de vigilance était là : Ferré3, le vieux Moreau, Avronsart, Lemoussu4, Burlot, Scheiner, Bourdeille. Montmartre s'éveillait, le rappel battait, je revenais en effet, mais avec les autres à l'assaut des buttes.
Dans l'aube qui se levait, on entendait le tocsin ; nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté.
On était comme soulevés de terre. Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines heures sont à l'avant-garde de l'océan humain.
La Butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance.
Tout à coup je vis ma mère près de moi et je sentis une épouvantable angoisse ; inquiète, elle était venue, toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment.
Ce n'était pas la mort qui nous attendait sur les Buttes où déjà pourtant l'armée attelait les canons, pour les rejoindre à ceux des Batignolles enlevés pendant la nuit, mais la surprise d'une victoire populaire.
Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses ; les soldats restent immobiles.
Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs se place devant sa compagnie et plus haut que Lecomte crie : Crosse en l'air ! Les soldats obéissent. C'était Verdaguerre, qui fut, pour ce fait surtout, fusillé par Versailles quelques mois plus tard.
La Révolution était faite.
(…) La victoire était complète ; elle eut été durable, si dès le lendemain, en masse, on fût parti pour Versailles où le gouvernement s'était enfui.
Beaucoup d'entre nous fussent tombés sur le chemin, mais la réaction eût été étouffée dans son repaire. La légalité, le suffrage universel, tous les scrupules de ce genre qui perdent les révolutions, entrèrent en ligne comme de coutume. »
Louise Michel, La Commune, histoire et souvenirs, La Découverte/Poche, 1999 (1ère édition, 1898)
Fin février 1871, Victorine Malenfant épouse Rouchy puis Brocher (4 septembre 1839-4 novembre 1921), rentre d'Orléans à Paris avec son mari qui, fait prisonnier par les Allemands, s'est évadé. Elle-même, après avoir participé comme ambulancière à des opérations sur la Marne et aux remparts à Auteuil, démissionne, suite à des démêlés avec son capitaine, de la 7e compagnie du 17e bataillon de la Garde nationale.
« Vers 10 heures du matin, nous entendîmes des marchands de journaux crier dans les rues de Paris : « Surprise, Montmartre attaqué, canons pris, la Garde nationale fraternise avec l'armée, les soldats mettent la crosse en l'air, le général Lecomte est prisonnier ! »
Mon mari et moi nous allâmes pour savoir ce qu'il y avait de vrai dans ces racontars. Le faubourg Saint-Germain semblait si éloigné de la vie active des autres faubourgs.
Nous passâmes sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où il y avait une grande animation. Les vendeurs de journaux avaient dit vrai. Le comité central au complet était réuni à l'Hôtel de Ville. Ils étaient tous trop heureux, le soleil s'était mis de la partie, une journée splendide. Le Paris qui voulait son affranchissement semblait respirer une atmosphère plus salutaire ; nous pensions en effet qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir. Mais il ne suffit pas d'avoir triomphé, il faut savoir garder le terrain conquis.
Le peuple et le comité central ne pensaient même pas à prendre des mesures nécessaires pour continuer leur victoire et assurer son succès. Il était 2 heures environ, lorsque nous étions à la place de l'Hôtel-de-Ville ; tout le monde avait l'air en fête, et ce pauvre Paris qui a toujours besoin de clinquant nous donnait le spectacle d'un magnifique défilé militaire de la ligne, des gendarmes allant à Versailles, qui, avec des caisses, des malles, des paquets sur leurs épaules, emportaient avec eux argent et archives ; et, qui plus est, tous ces gaillards allaient renforcer les bataillons des Thiers et Cie, lesquels en réalité étaient en désarroi, en ce moment-là. On dit que le peuple est méchant et cruel, moi je dis qu'il est bête ; c'est toujours le pauvre oiseau qui se laisse plumer, et cette fois vraiment, il le fit bêtement, stupidement.
(…) La journée du 18 mars, si belle à son aurore, était vaincue d'ores et déjà au déclin du jour. L'insuccès de la révolution est tout entier dans cette journée qui promettait tant.
Si, au premier moment d'effervescence, on avait fermé les portes de la capitale et empêché de dévaliser archives et monnaie et fait bonne justice de ces gens-là, je ne dis pas en les tuant, mais en les faisant simplement prisonniers, jusqu'à ce que la force morale eût vaincu la force brutale, Thiers n'aurait pas eu le temps de tromper l'opinion publique de la province par ses mensonges et ses corruptions. »
Victorine Brocher, Souvenirs d'une morte vivante, Une femme du peuple dans la Commune de 1871, Libertalia, 2017 (1ère édition, 1909)
Prosper-Olivier Lissagaray (24 novembre 1838-25 janvier 1901), installé à Paris depuis 1860, journaliste, participe à la proclamation de la République en septembre 1870 et se met à la disposition de Gambetta. Successivement chef de cabinet, commissaire de guerre à Toulouse, chef d'escadron d'état-major dans l'armée du général Chanzy , il quitte son régiment à l'annonce des événements du 18 mars 1871 et regagne Paris pour se consacrer à ses activités de journaliste.
« Vers trois heures, les bataillons populaires du Gros-Caillou défilèrent devant l'hôtel, tambours et clairons en tête. Les ministres se crurent perdus. M. Thiers se sauva par un escalier dérobé et partit pour Versailles tellement hors de sens que, au pont de Sèvres, il donna l'ordre écrit d'évacuer le mont Valérien.
(…) A sept heures et demie, l'Hôtel-de-Ville est cerné. Les gendarmes qui l'occupent s'enfuient par le souterrain de la caserne Lobau. Vers huit heures et demie, Jules Ferry et Fabre, totalement abandonnés par leurs hommes, laissés sans ordres par le Gouvernement, partent à leur tour. Peu après, la colonne Brunel débouche sur la place et prend possession de la Maison commune déserte et noire. Brunel fait allumer le gaz et hisser le drapeau rouge au beffroi.
(...) La place vivait comme en plein jour. Par les croisées de l'Hôtel-de-Ville on voyait circuler la vie, mais rien qui ressemblât aux tumultes passés. Les sentinelles ne laissaient pénétrer que des officiers ou des membres du Comité Central. Ils étaient arrivés un à un depuis onze heures et se trouvaient réunis une vingtaine dans ce même salon où avait conférencié Trochu, très anxieux et très hésitants. Aucun d'eux n'avait rêvé ce pouvoir qui tombait si lourdement sur leurs épaules. Beaucoup ne voulaient pas siéger à l'Hôtel-de-Ville, répétaient sans cesse : « Nous n'avons pas mandat de Gouvernement » ; la discussion renaissait à chaque nouvel arrivant. Un jeune homme, Edouard Moreau, mit de l'ordre dans les idées. Il fut convenu qu'on ne pouvait abandonner le poste conquis, mais qu'on n'y resterait que pour les élections, deux ou trois jours au plus.
(…) La nuit fut calme, d'un calme mortel pour la liberté. Par les portes du sud, Vinoy emmenait à Versailles régiments, artillerie, bagages. Les soldats se traînaient, insultaient les gendarmes. L'état-major, suivant ses traditions, avait perdu la tête, oubliait dans Paris trois régiments, six batteries, toutes les canonnières qu'il eût suffi d'abandonner au cours de l'eau. La moindre démonstration des fédérés eût arrêté cet exode. Loin de fermer les portes, le nouveau commandant de la garde nationale, Lullier, laissa – il s'en est vanté devant le conseil de guerre – toutes les issues à l'armée. »
Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, La Découverte/Poche, 2000 (1ère édition, 1876)
Leur récit, certes délivré après les événements de mai, est limpide et rejoint les analyses de Karl Marx et de Friedrich Engels sur l'offensive qui aurait dû être menée dès le 18 mars 1871 contre Versailles et sur la réquisition de l'or de la Banque de France5 Ces deux épisodes démontrent pour nous la sagacité de la formule célèbre de Marx : « Mais la classe ouvrière ne peut pas simplement mettre la main sur une machine d'État toute faite et la manier à ses fins propres ». Ainsi que l'écrit Léon Trotsky en 1921 : « Nous pouvons ainsi feuilleter page par page l'histoire de la Commune et nous y trouverons une seule leçon : il faut une forte direction de parti »6.
1. Karl Marx, La Guerre civile en France, 1871 : La Commune de Paris, Londres, 30 mai 1871.
2. Germain Turpin, garde national, était un ouvrier maçon de 36 ans.
3. Théophile Ferré (6 mai 1846-28 novembre 1871), membre de la Commune, substitut du procureur puis délégué à la Sûreté générale, exécuté à Satory.
4. Benjamin Le Moussu (14 juin 1846-25 mai 1907), commissaire aux délégations judiciaires de la Commune.
5. Sur l'offensive contre Versailles : voir la lettre de Karl Marx à Karl Liebknecht du 6 avril 1871 ; sur la Banque de France, voir l'introduction de Friedrich Engels du 18 mars 1891 à La Guerre civile en France de Karl Marx.
6. Léon Trotsky, Les Leçons de la Commune, février 1921.
 Prosper-Olivier Lissagaray
Prosper-Olivier Lissagaray Victorine Malenfant
Victorine Malenfant Louise Michel
Louise Michel Adolphe Thiers
Adolphe Thiers Paris, Montmartre, Champ des Polonais, canons, 1871
Paris, Montmartre, Champ des Polonais, canons, 1871 Paris, Montmartre, rue de la Bonne,1871 (photo de Bruno Braquehais)
Paris, Montmartre, rue de la Bonne,1871 (photo de Bruno Braquehais) Dossier La Commune de Paris 150e anniversaire
Dossier La Commune de Paris 150e anniversaireNotre journal La Commune propose à ses lecteurs deux dossiers consacrés au 150e anniversaire de la Commune de Paris : le premier, dans le numéro 127, retrace, à la lecture de La Guerre civile en...
 Dossier santé
Dossier santé30 004 morts : le bilan du COVID-19 en Franceest le résultat de 40 ans d'attaques de l'hôpital public !TOUS COUPABLES ET RESPONSABLES ! En France, la population paye un très lourd tribut humain,...
 Le projet Macron de réforme des retraites en 10 questions-réponses
Le projet Macron de réforme des retraites en 10 questions-réponsesL'histoire de notre système de retraites par répartition, celle de sa casse, des « réformes » successives et des discours qui les accompagnent, est essentielle pour comprendre le projet Macron,...
 Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Qu’est-ce que l’Union européenne ?Première partie Nous sommes partisans de la rupture avec l’Union européenne et ses institutions. Nous militons pour l’abrogation des traités dit « européens » et inconditionnement pour «...
 Comment naît le besoin d’un parti des travailleurs
Comment naît le besoin d’un parti des travailleurs« Personne ne nous représente ». Cet ouvrier de Roubaix sollicité par le Point 1 à propos des élections exprime la sensation de millions de salariés. Beaucoup de gens ne supportent plus ces...
 Pourquoi militer avec La Commune ?
Pourquoi militer avec La Commune ?Notre journal La Commune paraît depuis bientôt vingt-cinq ans. Notre site web met à la disposition de tous quinze années d’archives (articles – documentation - lettres d’information -...