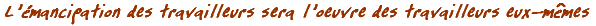La Charte d'Amiens : un acquis à défendre
Une histoire bien vivantePeut-on encore se réclamer de la Charte d’Amiens ? A cette question, des camarades dans le NPA répondent en substance que cette Charte est un document réformiste, fruit d’une alliance entre les courants libertaires et réformistes de la CGT naissante contre l’aile marxiste.
A la Charte d’Amiens et au principe d’indépendance réciproque des syndicats et des partis, ces mêmes camarades opposent une foultitude de citations de Marx, Lénine, Trotsky mais oublient toutefois de citer le paragraphe du Programme de transition : « les syndicats à l’époque de transition » dans lequel on peut lire : (les bolchevik-léninistes) luttent implacablement contre toutes les tentatives de soumettre les syndicats à l’Etat bourgeois et de lier le prolétariat par « l’arbitrage obligatoire » et toutes les autres formes d’intervention policière, non seulement fasciste mais aussi « démocratiques »
Or, la Charte d’Amiens, en son temps, procédait de cette lutte opiniâtre contre les tentatives d’inféoder la jeune CGT à l’Etat bourgeois. Et, il faut bien le dire, les syndicalistes-révolutionnaires furent à la pointe de ce combat. Le courant syndicaliste-révolutionnaire n’était d’ailleurs pas composé uniquement de libertaires et tous les anarchistes ne furent pas partisans de l’apolitisme de la CGT. Apolitisme que les détracteurs de la Charte d’Amiens confondent bien à tort avec neutralité politique. Quant à l’aile marxiste de la CGT, il est plus juste de dire « guesdiste » (du nom du dirigeant socialiste Jules Guesde), force est de reconnaître qu’elle se fourvoyait sur la question syndicale, tant par dogmatisme que par adaptation au parlementarisme. Du reste, tout le monde s’accorde à voir dans le marxisme français, un marxisme formel, schématique, combinant le sectarisme et l’opportunisme, et qui devait sombrer dans l’Union sacrée en août 1914. A la marge, ce caractère inabouti et désincarné du marxisme « à la française » (dont Marx et Engels raillaient le chauvinisme latent) explique pourquoi des militants comme Fernand Pelloutier évoluèrent du Guesdisme à l’anarchisme.
Engels, lui-même, écrira : « Ce que l’on appelle « marxisme » en France est certes un article tout spécial, au point que Marx a dit à Lafargue : « Ce qu’il y a de certain, c’est que moi je ne suis pas marxiste [1] ». Nos allergiques à la Charte d’Amiens dans le NPA soutiennent que ces militants guesdistes avaient raison en 1906 de revendiquer la liaison entre la CGT et le Parti socialiste qui venait d’être unifié. Ils affirment qu’en faisant obstacle à cette liaison, la Charte d’Amiens se dressait contre le Front unique ouvrier. Pas moins !
Mais, le front unique, ce n’est pas à proprement parler la liaison permanente ou systématique d’organisations ouvrières, en tout cas pas dans l’acception marxiste du mot, à moins de considérer comme les lambertistes que le Front Unique est une stratégie. Pourtant Trotsky indique :
« Une politique de front unique présuppose un accord des organisations ouvrières (politiques, syndicales, etc.) pour un travail en commun, indépendamment de leurs positions sur les questions principielles, en vue de la réalisation d’un certain nombre d’objectifs pratiques spécifiques – non pas une coopération permanente, mais un accord sur tel ou tel point pour une durée limitée par la nature même de la tâche en question [2]. »
Au demeurant, la Charte d’Amiens se situe dans la continuité des statuts de la CGT mis au point quatre années auparavant, au Congrès de Montpellier, lorsque la Fédération des Bourses du Travail s’y intègre définitivement. Elle résulte de toute la genèse du syndicalisme ouvrier indépendant fédéré et confédéré, de 1871 au début du vingtième siècle.
La gestation du syndicalisme ouvrier indépendant
Lorsque, au début des années 1880, le mouvement ouvrier se remet difficilement et laborieusement de la terrible répression de la Commune de 1871 qui l’a décimé, on dénombre en tout et pour tout 500 chambres syndicales ouvrières pour un effectif total de 60 000 syndiqués.
Lentement, pas à pas, l’idée d’une Union syndicale nationale fait son chemin, tandis que piétinent les efforts pour former en France un Parti ouvrier socialiste unifié.
Création de la Fédération nationale des syndicats
De 1880 à 1890 : le développement des syndicats est chaotique. En 1890, il y a près de 140 000 syndiqués dans un millier de chambres syndicales. Ils ont été légalisés par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884. Deux ans plus tard, le 11 octobre 1886, à l’occasion du 1er Congrès des syndicats ouvriers réuni à Lyon, est créée la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatif (FNS) qui, dans son premier mouvement, revendique son autonomie vis-à-vis des partis socialistes et qui, par la suite, sera influencée par les guesdistes regroupés dans le Parti ouvrier français (POF). Il est à noter que le second Congrès des syndicats ouvriers en 1887 pose, pour la première fois, la question de la grève générale. Les guesdistes qui, dans un premier temps, ont adhéré à cette perspective mise en avant par des militants anarchistes (en particulier, le menuisier Jules Tortelier), vont se raviser par la suite et considérer qu’elle est prématurée.
Par la suite, la tactique de la grève générale fera l’objet d’âpres polémiques entre militants syndicaux et entre militants socialistes. De plus en plus, encouragés en cela par de premiers succès électoraux, les guesdistes opposent à la grève générale voire à « l’action directe » (grèves et manifestations), l’activité électorale et parlementaire. A telle enseigne que Jules Guesde écrira à propos de la manifestation du 1er mai 1892 : « C’est dans les urnes que s’accomplira en France cette année la manifestation devenue action. C’est en installant nos élus dans les Hôtels de Ville… que notre prolétariat affirmera sa solidarité avec le prolétariat du monde entier » (Le socialiste, le 23 avril 1892) [3] . Il se trouve que les élections municipales se déroulent en mai.
Grève générale, action parlementaire et action syndicale
Loin de nous l’idée de remettre en cause cette tactique électorale et parlementaire durant cette période, indispensable pour permettre la constitution du prolétariat en classe séparée du Capital et donc des partis bourgeois. Engels, qui est encore en vie, devait écrire un an plus tard : « Je me trompe peut-être mais il me semble que cette année le 1er mai ne jouera pas, dans la vie du prolétariat, le rôle prépondérant que les trois années précédentes. En France certainement, en Allemagne très probablement, en Angleterre peut-être, l’année courante verra l’importance du 1er mai éclipsée par celle des élections générales, où le prolétariat sera appelé à conquérir de nouvelles positions et, où, sans doute, il les conquerra. (…) Les démonstrations sont choses excellentes, mais seulement tant que nous n’avons pas mieux à faire » [4]. Mais Engels ne manquera pas de railler les illusions « grotesques » de Jules Guesde qui avait qualifié son élection à Roubaix de « véritable révolution » [5]
D’autres indices permettent de montrer que Guesde, grisé par les premiers succès, passe de la tactique parlementaire au parlementarisme. Dans une lettre à Laura Lafargue, Engels reproche à Guesde d’avoir formé un groupe parlementaire avec ceux des blanquistes qui se sont acoquinés avec le général Boulanger après avoir coupé les ponts avec les blanquistes de « la vieille école » qui ne s’étaient pas laissé embarquer dans l’aventure bonapartiste voire « préfasciste » pour employer volontairement un terme nécessairement anachronique, du général Boulanger : « La rupture avec les blanquistes de la vieille école a peut-être été inévitable et il faut s’en accommoder ; mais je ne vois pas le moindre avantage réel à retirer pour nous d’une alliance avec les radicaux ex-boulangistes de la Chambre. N’avons-nous pas, pour le plaisir de faire étalage d’un groupe de quelque vingt-cinq députés au Parlement, sacrifié de très sérieuses chances pour l’avenir [6]. Il est à noter que, dans ce même courrier, Engels souligne la nécessité de s’inscrire dans la préparation des manifestations du 1er mai 1892 que Guesde dédaigne comme on l’a vu précédemment, du fait de l’approche des municipales. A la différence de Guesde, c’est à l’aune de la situation européenne et non française qu’Engels ajuste la tactique à adopter chaque 1er Mai. En 1893, il y a, cette fois, des échéances électorales importantes non seulement en France mais aussi en Belgique, Allemagne, Angleterre, ce qui modifie évidemment la donne du 1er mai.
Toujours est-il qu’en s’arc-boutant de plus en plus contre l’idée de la grève générale au nom de la lutte politique, les guesdistes se tirent une balle dans le pied et perdent leur prépondérance dans la Fédération nationale des syndicats. La grève générale va servir de bélier - et de prétexte dans l’offensive antiguesdiste que vont mener de concert « allemanistes », « blanquistes » et anarchistes au sein de la FNS, tandis qu’émerge une autre fédération nationale, la fédération des bourses du Travail.
Bien entendu, l’histoire des dissensions au sein du syndicalisme ouvrier naissant (ou plutôt renaissant car, de 1830 à 1871, les syndicats avaient connu de premiers et prometteurs développements dont l’élan a été brisé par l’écrasement de la Commune de Paris) ne saurait être présentée comme un combat entre des syndicalistes révolutionnaires purs et des guesdistes sectaires.
Création de la Fédération des Bourses du Travail
Ainsi, la création de la Fédération des Bourses du Travail en février 1892 ne fut pas une entreprise ingénue, libre de toute arrière-pensée. Son principal dirigeant, Fernand Pelloutier, n’en fait pas mystère. Dans son Histoire des Bourses du Travail, il l’avoue bien volontiers : « L’idée de fédérer des Bourses du Travail était inévitable. Nous devons à la vérité reconnaître qu’elle eut une origine plus politique qu’économique. Elle vint à quelques membres de la Bourse de Paris qui, adhérents à des groupes socialistes rivaux du Parti Ouvrier Français et mécontents de ce que la Fédération des syndicats fût entre les mains de ce Partibr/> [7]
Encore que, à ce moment-là, Fernand Pelloutier ne désespère pas de convaincre Jules Guesde du bien-fondé de l’action en faveur de la grève générale. La motion qu’il parvient à faire adopter par le congrès ouvrier régional de Bordeaux en septembre 1892 proclame : « la suspension universelle et simultanée de la force productrice, c’est-à-dire la grève générale, qui, même limitée à une période relativement restreinte, conduirait infailliblement le Parti Ouvrier au triomphe des revendications formulées dans son programme ». Membre du même parti que lui (le POF), Pelloutier adressera à Jules Guesde une Lettre ouverte dans la Démocratie de l’Ouest (5 octobre 1892). Guesde lui répondra une semaine plus tard (Le Socialiste, 16/10/1892).
Pour Jules Guesde (dans Le Socialiste du 10/05/1892) : « Pour une pareille grève, en effet, il faudrait, comme son nom l’indique la généralité des travailleurs entraînés dans le même mouvement, alors que pour faire la révolution, c’est-à-dire pour chasser la bourgeoisie du gouvernement, il suffit, les circonstances aidant, d’une forte minorité ouvrière ». [8] Où est le marxisme dans cette réplique ? On cherche encore…
Dans sa réponse à Pelloutier, il se lâche carrément : « Ce n’est pas cinquante ans, c’est un siècle ou deux qu’exigerait cette suspension générale du travail, qui ne saurait cesser d’être un mot vide pour devenir une réalité victorieuse qu’autant que la généralité des travailleurs y seraient consentants et participants » [9]
A l’origine, rien ne prédestinait les Bourses du Travail à devenir une des bases fondatrices du syndicalisme ouvrier indépendant et partant, de la CGT. Initialement, ces Bourses ont pour but la création d’un marché du travail. Dans cet optique, une proposition est déposée au bureau du Conseil municipal de Paris, le 24 février 1875 : « Les soussignés demandent qu’il soit procédé à l’étude de l’établissement, à l’entrée de la rue de Flandre, d’une Bourse du travail, ou au moins d’un refuge clos et couvert, afin d’abriter les nombreux groupes d’ouvriers qui se réunissent chaque matin pour l’embauchage des travaux du port et autres. »
Le projet verra le jour le 22 mai 1892, jour de l’inauguration de la Bourse du Travail, rue du Château-d’Eau et qui occupe tout un immeuble. Le Président du Conseil municipal le concède aux ouvriers syndiqués « avec la confiance qu’elle serait un instrument de pacification sociale qui contribuerait un jour à établir la paix universelle ». [10]]]
Des Bourses s’implantent dans de nombreuses villes, détournées de leur vocation initiale par les militants ouvriers qui se les approprient et en font des foyers de démocratie ouvrière, des lieux d’organisation de la solidarité, de l’assistance et de l’éducation.Cité dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 143. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970.
Des Bourses se constituent, d’abord à Paris, le 3 février 1887 puis à Nîmes la même année, en 1888 à Marseille, en 1889, à Saint-Etienne ; en 1890, à Toulon, Toulouse et Bordeaux. En 1891, on recense 14 Bourses. 24 en 1893.
Au congrès qui donne naissance à la fédération nationale des Bourses du Travail, à Saint Etienne le 7 février 1892, 10 Bourses sont représentées. Leur premier mouvement hautement significatif est de repousser « d’une façon absolue l’ingérence des pouvoirs administratifs et gouvernementaux dans le fonctionnement des Bourses, ingérence qui s’est manifestée par la déclaration d’utilité publique qui n’a été proposée par le gouvernement que pour nuire à leur développement ». [11].
Le Manifeste des Bourses adoptée ce jour- là affirme : « Le prolétariat conscient, oubliant les néfastes divisions qui avaient paralysé ses efforts, est uni…autour de la Fédération des bourses, toutes les forces ouvrières ne formeront qu’un seul bloc, uni par des intérêts communs, aimanté par la solidarité. Solidarité. Unité » [12]
La fondation définitive de la Fédération des Bourses du Travail sera ratifiée par le Congrès de Toulouse en 1893 qui en élabore les statuts dont l’article 1er précise :
« Une fédération est formée entre les Bourses du travail. Elle a pour but :
1) D’unifier et de faire aboutir les revendications des syndicats ouvriers
2) D’étendre et de faire aboutir les revendications des syndicats ouvriers
3) D’étendre et de propager l’action des Bourses du travail dans les centres industriels et agricoles
4) De nommer les délégués au secrétariat national du travail
5) De réunir tous les éléments statistiques et de les communiquer aux Bourses adhérentes et, en même temps, de généraliser le placement gratuit des travailleurs des deux sexes de tous les corps d’état » [13].
La Bourse est donc le cœur de réseaux reliant entre eux les travailleurs d’une même localité. Les Bourses sont abondées par les cotisations des syndicats qui s’y agrègent et les subventions de municipalités. Les services qu’elles dispensent sont : Mutualité ; Enseignement ; Propagande ; Résistance. Les services de Mutualité sont : le placement, les secours de chômage, les secours en cas d’accident. Le Placement gratuit par les Bourses succède au Placement payant. Le secours de route, dit viaticum, permet aux ouvriers au chômage d’aller d’une localité à l’autre pour chercher du travail. Le service de secours aux accidents comprend un service médical et un service juridique. Les principaux services d’enseignement sont les bibliothèques et les cours.
Ainsi, en 1911, on ne dénombre pas moins de 131 bibliothèques créées par 144 Bourses du travail de France et 31 créées par des Unions locales ou régionales de syndicats. Quant aux cours, ils visent tout à la fois au perfectionnement de l’ouvrier et à son instruction et sa culture générale.
Partant, les Bourses du travail sont le creuset des Unions locales de syndicats des différentes corporations d’une même ville. Fernand Pelloutier va en être l’architecte. Et sa conception des Bourses arrachées à la tutelle patronale n’est en rien étrangère à l’idée de Grève générale qu’il poursuit. Le jour venu, les Bourses seront les piliers de l’organisation de la Grève…
Evidemment, on a souvent raillé l’idée de la grève générale présentée par les syndicalistes-révolutionnaires comme étant la panacée universelle. Nos anti-Charte d’Amiens n’échappent à ceux qui ironisent au sujet des propagandistes de la grève générale. Tout cela parce que la Grève générale n’était pas à l’ordre du jour. Ce qui est rigoureusement vrai, d’ailleurs. Les critiques que Marx et Engels adressaient à la conception bakouniniste de la grève générale qui, comme l’a rappelé Rosa Luxemburg « oppose la grève générale, facteur de déclenchement de la Révolution sociale, à la lutte politique quotidienne du prolétariat » [14] , étaient pertinentes. Il n’empêche que l’aspiration à la grève générale parmi les ouvriers avancés agissait comme un ressort et un ferment pour le développement de l’action syndicale sous tous ses aspects et de cristallisation du syndicalisme de lutte de classes. L’histoire dira que ces militants étaient en avance de quelques années seulement. 10 ans après, réfléchissant sur les leçons de la Révolution de 1905 en Russie, Rosa Luxemburg écrira la fameuse brochure « grèves de masse, partis et syndicats » qui est sans conteste à porter au crédit du marxisme vivant et qui prend l’exact contrepied des propos tenus par Jules Guesde onze années auparavant.
Dans la motion qu’il soumet devant le XII ème Congrès du POF, Jules Guesde écrit « Instrument inégal et partiel de défense dans la présente société, à plus forte raison la grève ne saurait-elle être même généralisée- l’outil de l’affranchissement ouvrier. Préparer la grève générale, ce serait conduire le prolétariat dans une impasse, le diviser contre lui-même, en grévistes et non-grévistes, ce serait immobiliser, dans la lutte pour la libération commune, les travailleurs des campagnes et organiser nous-mêmes notre défaite ». [15] Pour faire bonne mesure, la motion Guesde martèle « ce n’est que par l’action politique, par la conquête du pouvoir politique que les travailleurs organisés pourront s’émanciper en socialisant les moyens de production, de transport et de distribution des produits ». Ce faisant, il produit une conception symétrique à la conception anarchiste : il oppose l’action politique à « la grève » générale ou non. Il oppose la fin aux moyens de s’y hisser.
Onze ans plus tard, Rosa Luxemburg écrira « En un mot : la grève de masse, comme la révolution Russe nous en offre le modèle, n’est pas un moyen ingénieux inventé pour renforcer l’effet de la lutte prolétarienne mais elle est le mouvement même de la masse prolétarienne, la force de la manifestation de la lutte prolétarienne au cours de la révolution » [16]
La naissance de la CGT
A partir de 1892, le développement syndical de la classe ouvrière s’accélère :
. 1892 : 1589 syndicats et 288 770 syndiqués
. 1895 : 2 169 syndicats et 419 172 syndiqués
Au 31 décembre 1899 : 2 685 syndicats et 492 647 syndiqués [17]
S’agissant des Bourses du travail :
. 1895 : 31 Bourses, 600 syndicats
. 1896 : 46 Bourses, 862 syndicats
. 1898 : 51 Bourses, 947 syndicats
. 1900 : 57 Bourses, 1065 syndicats soit 48% du nombre total des syndicats ouvriers répartis sur le territoire national ; Sur 57 Bourses, 48 sont affiliées à la fédération et groupent 870 syndicats [18].
Dans le même temps, les partis socialistes connaissent leur premier essor sur le terrain électoral, terrain déformé de la lutte des classes, qui permet de conquérir des municipalités qui sont autant de positions, de points d’appui et d’intervenir en faveur de lois sociales qui renforcent la position de la classe ouvrière dans la société bourgeoise, en la dotant de droit et garanties qui scellent sa cohésion, accroissent son unité, contribuent à la faire sortir de l’état de masse disséminée.
Répétons-le : en opposant l’action syndicale à l’action politique, anarchistes et guesdistes se retrouvent sur des positions symétriques qui se confortent mutuellement.
Faute de comprendre que l’indépendance réciproque des partis socialistes et des syndicats est la seule base possible de relations saines au sein du mouvement ouvrier combinant l’action sur le terrain électoral et l’action corporative, les guesdistes vont se placer d’eux-mêmes en dehors du processus de concentration syndicale. Ils vont se faire piéger par leurs adversaires qui vont tirer profit de l’aversion des guesdistes pour la grève générale et leur dédain à l’égard des grèves de masse qui prennent pourtant un tour explosif. Répétons-le autant de fois que nécessaire : la schématisation absurde de la position marxiste (l’utilisation de toutes les ressources du suffrage universel comme moyen d’aider le prolétariat à s’affranchir de la tutelle bourgeoise et à arracher des réformes à son avantage) conduira à sa négation opportuniste, laquelle, poussée jusqu’à ses ultimes conséquences, fera de Guesde un ministre d’Etat, au premier coup de semonce de la Guerre de 14.
A l’inverse, les syndicalistes-révolutionnaires, empiriquement, parviennent, pour une partie d’entre eux, à se hisser à l’avant-garde des masses, sans craindre, au besoin, de se placer à contre-courant. Ils fourniront les meilleurs bataillons de la minorité anti-guerre en 14-18.
Si les livres d’histoire nous enseignent que la CGT fut fondée en 1895, rares sont les historiens qui font mention du Congrès de Nantes qui, l’année précédente, fut le prélude de la fondation de la CGT.
En septembre 1894, se tient le Congrès corporatif de Nantes, représentant, ce qui est un record pour l’époque, 1 662 syndicats. La question de la grève générale est au cœur des débats. Lorsque la question est mise aux voix, la position favorable à la grève générale l’emporte par 65 voix contre 37 et 9 abstentions. Les guesdistes quittent la séance et scissionnent de fait, décidant de maintenir comme un appendice de leur Parti, la Fédération nationale des syndicats, réduite à la portion congrue. Des provocateurs comme Girard (on apprendra après sa mort sa qualité d’indicateur de Police lié au Préfet Lépine) et Aristide Briand en rajoutent dans le registre de la Grève générale pour souffler sur les braises de la division. Les guesdistes tombent dans le panneau, les yeux fermés.
Un an plus tard, faisant suite aux deux congrès unitaires où se retrouvent les syndicalistes des deux fédérations (la fédé des syndicats et la fédé des Bourses), celui de Paris en 1893 et de Nantes que nous venons d’évoquer, se tient le Congrès corporatif de Limoges (dont les guesdistes se tiennent résolument à l’écart) et qui donne naissance à la Confédération générale du travail. Née de la volonté de parachever l’unité et l’indépendance du syndicalisme de Lutte de classes, la création de la CGT ne met pas fin pour autant à l’existence, en parallèle, de la fédération des Bourses du Travail. La CGT semble prolonger l’existence de la fédération nationale des syndicats qui a donné corps à des fédérations de métiers.
La dynamique des grèves
On l’a noté plus haut : la grève devient progressivement l’arme par excellence du prolétariat en phase de réveil, vingt ans après l’écrasement de la Commune de Paris. Ainsi que Marx l’envisageait, les grèves contiennent les germes de la guerre civile et inquiètent les tenants de l’ordre bourgeois et contraignent les capitalistes à céder à des revendications qui ont trait au salaire et au temps de travail.
Ainsi, en 1886, une grève explosive prend corps à Decazeville pour arracher des salaires décents. Au cours d’un affrontement, le directeur de l’usine est tué et les ouvriers, jugés responsables de cette mort, seront condamnés à des peines de prison et de travaux forcés.
Cette tendance aux grèves a trouvé son prélude dans les mines, à Anzin, en 1884, sous l’impulsion du syndicat fondé deux ans plus tôt par le Parti ouvrier de Guesde et de son responsable, Basly qui sera chassé des mines puis élu député socialiste de Paris, un an plus tard sur une liste de concentration républicaine, avant de devenir un opportuniste patenté, un des premiers « lieutenants ouvriers de la bourgeoisie » en France ( à telle enseigne que le syndicat des mineurs se divisera plus tard en un « vieux syndicat » dirigé par les « baslycots » et un « jeune syndicat » où cohabitent guesdistes et anarchistes, unis contre les « réformistes ».)
Le tournant vers les grèves de masse est pris au moment du Congrès corporatif de la Toussaint 1888, à Bordeaux-le-Bouscat, qui- cherchant les voies et les moyens de la grève générale et s’inspirant de l’exemple donné en 1886 par les travailleurs américains- appellent à un premier mouvement d’ensemble les 10 et 24 février 1889. A l’appui de cette perspective, la résolution adoptée rappelle :
« Nous avons d’ailleurs pour exemple les grands mouvements ouvriers d’Angleterre et d’Amérique, où des centaines de mille de travailleurs, au même jour, à la même heure, accomplissent simultanément et exactement tel acte précédemment convenu et décidé dans les congrès »
Le but est clair, net et précis : obtention de la journée de 8 heures et du salaire minimum.
A ce moment-là, les guesdistes sont partie prenante de la mobilisation qui conduit au succès de ces deux journées revendicatives à caractère national et interprofessionnel.
Dans la foulée, 20 000 canuts lyonnais manifestent à la Préfecture, le 9 mars 1889 ;
Un an plus tard, sur proposition du congrès socialiste international de Paris qui s’est tenu le 20 juillet 1889, aura lieu la première manifestation internationale du 1er mai, le 1er mai ayant été retenu à l’honneur des martyrs de Chicago, condamnés à mort et exécutés après les manifestations du 1er mai 1886 en Amérique.
Le 16 avril 1890, dans une lettre à Laura Lafargue, Engels écrit : « La résolution sur le 1er mai est la meilleure qu’ait formulée notre congrès.
Elle prouve notre puissance dans le monde entier, elle ressuscite bien mieux l’Internationale que toutes les tentatives formelles de reconstitution » [19]. Cependant, Engels se défie des références à la grève générale. Critiquant un discours de Paul Lafargue, Engels raille « les rêveries de la grève générale » en expliquant : « Quand nous serons en mesure de tenter la grève générale, c’est qu’alors nous pourrons obtenir ce que nous voulons rien qu’en le demandant, sans le biais de la grève générale » [20]
Le 1er mai 1890 est un succès. Parmi les événements qui rythment cette journée de combat ouvrier, une grève éclate dans le textile à Vienne en faveur de la journée de 8 heures : les provocations policières entraînent des affrontements et la prise de la fabrique par les ouvriers. La répression sera implacable : condamnations, peine de prisons…Soulignons également la célébration éclatante de ce 1er mai à Roubaix, en terre guesdiste, où les ouvriers refusent de reprendre le travail tant qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause sur leurs revendications corporatives. Le mouvement prend un tour violent, l’état de siège est décrété et des militants guesdistes sont arrêtés.
Le 1er mai 1891, La violence contre les grévistes atteint son paroxysme : à Clichy se livre une bataille au cours de laquelle les ouvriers sont brutalisés et condamnés. Et, c’est le drame de Fourmies. Edouard Dolléans relate : « le 1er mai 1891 reste une date inoubliable : c’est l’affreuse journée de Fourmies. La population ouvrière avait coutume de fêter le Mai fleuri qu’on allait cueillir, puis planter sur la place où l’on dansait, selon les traditions de la région : les ouvriers se proposaient de fêter le renouveau par une matinée théâtrale et un bal. Les industriels avaient refusé de fermer les usines ce jour-là et ils avaient demandé au gouvernement d’envoyer deux compagnies d’infanterie et des renforts de gendarmerie. Dans l’après-midi, sur la place de l’église, des enfants, des jeunes gens et des jeunes filles s’avancent, curieux de voir les soldats. En tête, une jeune fille de 18 ans, Marie Blondeau, tenant en chantant une branche de gui au- dessus de sa tête. Le commandant ordonne de tirer. Ainsi que d’autres, Marie Blondeau tombe sous les balles ; elle a tout le haut du crâne emporté. Au bruit de la fusillade, l’abbé Margerin, accourt. Il emporte dans ses bras une jeune fille de 17 ans ; puis il s’avance vers la troupe et supplie le commandant Chapuis de cesser le feu : « Ah, je vous en conjure, ne tirez plus, voyez ces cadavres… » Et le commandant répond : « Je ne demande pas mieux ». [21] En revanche, à Lyon, ce même jour, 60 000 ouvriers et ouvrières forcent un barrage de cuirassiers.
Cette même année, une grève de 44 000 mineurs du Pas-de-Calais est déclenchée en dépit des manœuvres du député socialiste réformiste Basly.
En Avril 1893, Amiens est touchée par une vague de grèves édifiantes. Paul Lafargue, le gendre de Marx et l’homme qui, avec Guesde dirige le POF se rend sur les lieux et livre son témoignage à Engels dans une longue lettre, en situant l’origine du mouvement dans le mouvement gréviste engagé par les ouvrières tisseuses, soutenues par les teinturiers : « Là est l’origine de cette grève qui est devenue générale : toutes les corporations ont été entraînées par l’exemple ; et, si l’on avait eu des hommes sous la main, on aurait pu soulever toutes les petites villes industrielles des alentours d’Amiens.
Une seule conférence faite par moi à Corbie située à 18 km d’Amiens a déterminé les ouvriers des manufactures de chaussures à sortir des ateliers […] Tout marche à merveille ; les ouvrières ont obtenu ce qu’elles demandaient ; les teinturiers profitant de l’occasion ont imposé à leurs patrons un nouveau tarif ; d’autres corps de métiers, comme les déchargeurs du port ont également réussi ; mais les maçons, les menuisiers, les cordonniers au nombre de 4000, sont encore en grève.
L’attitude des ouvriers a été tellement calme et leurs revendications si justes qu’ils ont fini par gagner l’opinion publique. Les dons en argent et en nature arrivent au comité de la grève. Depuis le commencement, on s’était placé en dehors de la légalité stricte en faisant des manifestations et des processions dans les rues de la ville ; et en tenant des meetings en plein air sur les glacis des fortifications : j’ai cru le moment propice de violer la loi en envoyant une trentaine de femmes grévistes quêter dans la ville » [22]
Sur l’ensemble de la période 1870/1910, nous avons :
. Entre 1870 et 1880 : 30 000 grévistes déterminant un nombre de 500 000 journées chômées
. Entre 1890 et 1895 : 92 000 grévistes et 1 500 000 journées chômées
. 1900 : 4 000 000 journées chômées
. 1906 : 9 500 000 journées chômées
. 1910 : 4 800 000 journées chômées [23]
Et :« Selon la statistique établie par l’Office du travail, en 1900, il y a eu en dix ans, de 1890 à 1899, 4 194 grèves tenues par 922 080 ouvriers.
D’après le nombre des grèves, il y a eu 24,401% de réussites complètes, 31% de réussites partielles, 38,63% d’échecs. Au total les grèves furent défavorables à un tiers des ouvriers seulement. Evaluant les profits et pertes concernant 508 grèves de salaires, M. Ch. Gide calcule que ces grèves furent du placement à 235% », et il ajoute :
« A ce gain-là pour la classe ouvrière, il faudrait ajouter tout celui, impossible à calculer, qui se fait par ricochet, car toute hausse de salaire obtenue dans une industrie tend à se généraliser dans toutes les autres par la loi physique des vases communicants »
Parmi les autres résultats des grèves, il faut signaler, outre les augmentations de salaire et la réduction de la journée, la pratique du contrat collectif qui répond aux objectifs fondamentaux de l’action syndicale : empêcher la concurrence entre ouvriers. Les différentes grèves des mineurs du Nord aboutissent aux célèbres conventions d’Arras ( 1891-1898-1899-1900) fixant les salaires de base ; dans les cuirs et peaux, en 1892, un accord s’établit entre les ouvriers et les mégissiers d’Annonay sur les questions de salaire et de durée de la journée de travail ; les travailleurs des ports et docks en 1902-1903 ; les travailleurs de la terre du Midi en 1903-1904 signent également des contrats » [24]
Ministérialisme et tentatives d’intégration des syndicats
Comme on l’a vu, pour la génération de syndicalistes révolutionnaires qui se forme, l’unité syndicale est conditionnée par l’indépendance à l’égard des partis socialistes et des sectes anarchistes. Mais, l’histoire des Bourses du travail est là pour démontrer que cette génération de syndicalistes prolétariens recherche d’abord et avant tout l’indépendance complète du syndicat à l’égard de l’Etat et du Patronat. Dès le début, elle va être aux prises avec les tentatives d’intégration des syndicats initiées par les gouvernements bourgeois successifs corollairement à l’implacable répression des grèves et des militants syndicaux, menées selon le principe vieux comme Erode de la politique de la carotte et du bâton.
On l’a vu, la répression extrêmement dure et parfois meurtrière, l’arsenal juridique antigrève ne suffisent pas à endiguer la vague ouvrière qui se forme contre l’exploitation et ses conséquences.
Ici, un rappel juridique s’impose :
La loi du 25 mai 1864 concède le droit de grève ; la loi du 30 juin 1881, le droit de réunion et la loi du 22 mars, le droit syndical professionnel. Théoriquement, c’en est fait du délit de coalition qu’avait instauré la célèbre loi Le Chapelier, en 1791. Mais, au délit de coalition succède le délit dit « d’atteinte à la liberté du travail » déterminés par les articles 414 et 415 du Code pénal. Ce qui autorise la répression des grèves par l’armée et l’emprisonnement des syndicalistes et des grévistes.
Mais ce dispositif, à lui seul, ne suffit pas à mater la révolte ouvrière. De même que ne suffisent pas, loin s’en faut, les tentatives faites à partir de 1884, de mettre en place des syndicats chrétiens plaidant pour la collaboration des classes.
Les gouvernements républicains vont alors tenter de corrompre, de toutes les façons possibles, les syndicats et, plus largement, le mouvement ouvrier dans son ensemble.
Ces tentatives coïncident avec le « ministérialisme », posture qui consiste à accepter la participation de militants socialistes à des gouvernements bourgeois.
Rappelons-en le contexte : en 1898, à l’heure L’affaire Dreyfus défraie la chronique, les Républicains doivent faire face à une offensive des forces les plus réactionnaires, bonapartistes entre autres et nationalistes de la Ligue des patriotes de Déroulède qui, dans le sillage du général Boulanger veulent en finir avec le régime parlementaire et tentent un coup de force. A ce moment-là, les différents partis socialistes et socialistes indépendants, façon Jaurès, forment un comité d’entente qui pose, semble-t-il, un premier jalon d’unité.
Waldeck-Rousseau est nommé président du Conseil le 22 juin 1899, à un moment clé de l’Affaire Dreyfus. La Cour de cassation vient en effet, le 3 juin, de casser le jugement du conseil de guerre condamnant le capitaine Dreyfus et d’exiger sa révision. Il forme un gouvernement de Défense Républicaine. Waldeck-Rousseau est un républicain « modéré », pas même un républicain-radical ou radical-socialiste. Dans le gouvernement qu’il constitue, il appelle le général Galliffet, fusilleur de la Commune et… Alexandre Millerand, socialiste indépendant et partie prenante du comité d’entente.
Clémenceau, sur lequel Marx et Engels avaient fondé l’espoir qu’il se rallierait au mouvement ouvrier, s’exclama
« C’est un coup de théâtre. En vérité, c’est un étrange assemblage ; rien n’était plus inattendu que la rencontre de ces trois hommes dans une même action politique. Waldeck-Rousseau, l’ami, l’élève favori de Gambetta, l’un des représentants les plus autorisés de la politique dite opportuniste. Galliffet, qui fut aussi de l’intimité de Gambetta, un soldat, de l’école des sabreurs à panache, qui a malheureusement laissé dans nos guerres civiles une trace d’implacabilité légendaire. Millerand, enfin, un socialiste révolutionnaire qui revendique hautement les droits de la démocratie laborieuse, en vue de l’organisation de justice sociale si lente à venir. » [25]
Le 24 juin 1899, Jaurès écrit dans La Petite République :
« Pour ma part et sous ma responsabilité personnelle, j’approuve Millerand d’avoir accepté un poste dans ce ministère de combat. Que la République bourgeoise, à l’heure où elle se débat contre la conspiration militaire qui l’enveloppe, proclame elle-même qu’elle a besoin de l’énergie socialiste, c’est un grand fait ; quelle que soit l’issue immédiate, ce sera une grande date historique ; et, un parti audacieux, conquérant, ne doit pas, à mon sens, négliger ces appels du destin, ces ouvertures de l’histoire » [26]
Dans les semaines suivantes, le POF, le parti socialiste révolutionnaire et l’alliance communiste publient un manifeste daté du 14 juillet 1899 :
« Le Parti socialiste, parti de classe, ne saurait devenir, sous peine de suicide, un parti ministériel. Il n’a pas à partager le pouvoir avec la bourgeoisie dans les mains de laquelle l’Etat ne peut être qu’un instrument de conservation et d’oppression sociale. Parti d’opposition nous sommes. Parti d’opposition, nous devons rester, n’envoyant les nôtres dans les parlements et autres Assemblées électives qu’à l’état d’ennemis pour combattre la classe ennemie et ses diverses représentations politiques »
La polémique qui s’engage entre partisans et adversaires du « ministérialisme » (l’expression est de Jules Guesde), jaurésiens d’un côté, guesdistes, blanquistes et allemanistes de l’autre va tracer la ligne de clivage qui va traverser le Congrès d’unité réuni le 3 décembre 1899 au gymnase Japy à Paris (les syndicats y étaient conviés). Par 818 voix contre 634, le Congrès adopta un texte de Guesde affirmant nettement :
« La lutte de classe ne permet pas l’entrée d’un socialiste dans un gouvernement bourgeois » mais, à peine cette résolution adoptée, les guesdistes acceptent une formule de compromis prémonitoire, admettant par 1 140 voix que « la participation socialiste à un gouvernement bourgeois » [27] « dans des circonstances exceptionnelles » Les blanquistes s’y opposent par 240 voix. [28] Prémonitoire, cette formule laisse augurer la participation de Jules Guesde dans le gouvernement d’Union sacrée de la guerre de 14 « dans des circonstances exceptionnelles » …
Alexandre Millerand, pour sa part, reste au gouvernement, nanti du maroquin de ministre du Commerce. Et, le 15 novembre 1900, il dépose un projet de loi sur l’arbitrage obligatoire des conflits du travail qui sera finalement enterré mais qui n’en est pas moins significatif.
« Ce projet de loi créait des conseils d’usine, organisait l’arbitrage et réglementait la grève. Dans tout établissement d’au moins 50 ouvriers, le patron pouvait proposer aux ouvriers, au moment de l’embauche, de soumettre leurs différends éventuels à l’arbitrage. Lorsqu’un conflit éclatait, les délégués ouvriers, élus par tout le personnel ayant un certain temps de service, étaient reçus par le patron. En cas de désaccord, des arbitres étaient désignés de chaque côté, et le différend porté devant le Conseil régional du travail. La grève ne pouvait être décidée qu’en cas de refus du patron, si toutefois elle était votée par la moitié plus un des ouvriers représentant le tiers des électeurs appelés à désigner le Conseil d’usine. En ce cas, la grève était obligatoire pour tout le personnel ; mais le vote se renouvelait chaque semaine en vue de la continuation de la grève. » [29]
Le projet Millerand s’inspire tout d’abord la représentation du personnel qui existe à la filature de laine Harmel frères/ Val des Bois, dans la Marne. Selon JP Le Crom, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, cette représentation du personnel :
« Puise ses racines dans l’expérience des syndicats mixtes catholiques, eux-mêmes issus de l’Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers créée par le comte Albert de Mun après la Commune de Paris. Des uns à l’autre, la filiation est explicite : on retrouve au Val des Bois la même conception hiérarchique de la société qui faisait dire à de Mun : « Il n’y a pas de société viable en dehors de certains principes, que les hommes peuvent bien méconnaître, mais qu’il n’est pas en leur pouvoir de renverser. De ce nombre est le rôle social des classes élevées.16 » L’organe de représentation, appelé d’abord Conseil corporatif, puis Conseil professionnel, devient, en 1893, le Conseil d’usine.
En 1909, l’article 7 du règlement intérieur de l’usine du Val des Bois définit ainsi ses attributions :
« Le Conseil d’usine établit une réelle coopération des ouvriers à la direction professionnelle et disciplinaire de l’usine. Il a pour but de maintenir entre patron et ouvriers une entente affectueuse, basée sur une confiance réciproque. Il est composé de simples ouvriers élus qui se réunissent avec un patron tous les quinze jours ; » Ils sont appelés à donner leur avis pour toutes modifications de salaire, pour les mesures disciplinaires à prendre, pour les questions d’accidents, d’hygiène, d’apprentissage et de travail ; »
Ils sont les interprètes de leurs camarades pour les réclamations qu’ils ont à faire aux patrons ; »
Enfin ils étudient les réformes qui pourraient faciliter le travail et le rendre plus lucratif. »
Les ouvrières ont leur conseil spécial qui a les mêmes attributions. »
Le Conseil d’usine s’inscrit dans une forme de domination de la main d’œuvre que Gérard Noiriel, relisant Frédéric Le Play qui en fut le principal théoricien, a caractérisé sous le terme de patronage. Il s’agit « de conforter le monde traditionnel, d’adapter la main d’œuvre au travail industriel sans la heurter de front, mais au contraire en s’appuyant sur ses dispositions pour les orienter, les canaliser dans un sens favorable aux intérêts de l’entreprise.17 » Pour Léon Harmel, qui sera l’un des inspirateurs de Léon XIII dans la genèse de Rerum Novarum, le Conseil d’usine n’a pas pour seule fonction de faire connaître l’état d’esprit des ouvriers pour faciliter la décision patronale. Il s’agit aussi, à l’inverse, de transmettre la pensée de la direction, d’exercer en quelque sorte un rôle pédagogique, facilitant par là-même la compréhension des choix patronaux et l’obéissance à l’autorité légitimée.18 La coopération directe entre patrons et ouvriers est destinée à éviter les malentendus réciproques en favorisant les échanges sans médiation de la hiérarchie intermédiaire à l’usine » [30]
0
Comme on le voit, nous avons dans le Projet Millerand le germe du corporatisme social que systématiseront Mussolini, Salazar, Pétain et de Gaulle.
Qui plus est, le projet Millerand survient après les événements du Creusot et la mise en place des délégués maison dans ces usines Schneider.
0
« En 1899, deux grandes grèves agitent les ouvriers de Schneider dans la « ville-usine » du Creusot. La première, en mai-juin, se termine victorieusement pour les ouvriers qui réussissent à assurer la création d’un syndicat. La deuxième, en septembre-octobre, est l’occasion pour les syndicalistes d’une demande de réunions périodiques avec la direction. Le cahier de revendications préconise « qu’afin d’éviter les causes de conflit, nous puissions, tous les deux mois, hors les cas d’urgence, avoir une entrevue, soit avec vous, soit avec un de vos représentants, pour exposer les revendications, les plaintes recueillies.20 » À cette demande, Eugène Schneider répond : « Tous mes ouvriers savent qu’ils peuvent constamment et non pas seulement tous les mois, présenter, soit à leurs chefs, soit à moi-même leurs revendications. Je l’ai suffisamment répété.21 » Schneider laisse toutefois entendre qu’une représentation du personnel peut être envisagée, dans la mesure où elle est conçue en dehors du syndicat. Dans sa réponse aux grévistes, il souligne qu’il recherche « un moyen pratique de résoudre le problème, avec le particulier souci de créer une institution propre à nos usines et dans laquelle la totalité de notre personnel soit équitablement représentée.22 » Finalement un arbitrage du président du Conseil Waldeck-Rousseau aboutit, selon les recommandations de ce dernier, à la création de délégués d’atelier.
Malgré les pressions et un règlement électoral particulièrement défavorable aux syndiqués, les candidats du syndicat enregistrent de bons scores lors des premières élections. Mais la dernière manche de la partie est gagnée par Eugène Schneider. Après avoir créé un syndicat « jaune », le syndicat des corporations ouvrières, il provoque une nouvelle grève dont il sort vainqueur. Le syndicat CGT est liquidé et deux mille ouvriers syndiqués licenciés doivent quitter Le Creusot. De nouvelles élections sont organisées qui voient la victoire complète de Schneider : tous les élus sont sans étiquette ou membres du syndicat des corporations ouvrières. L’institution de délégués, dira Schneider après ces événements, lui a fait gagner « trente ans de paix sociale ». Et même un peu plus, serait-on tenté de dire, puisqu’il n’y aura plus de grève au Creusot avant 1945, pas même en 1936. » [31]
0
Mais, il faut dire aussi que le projet Millerand s’inspire aussi de la proposition de loi déposée devant la Chambre des députés, le 8 février 1894 par … Jules Guesde. Dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, Jules Guesde expliquait :
0
« La loi a reconnu, a dû reconnaître le droit de grève que ceux-là mêmes sont obligés d’admettre en théorie, qui s’efforcent de l’annuler dans la pratique. Mais elle ne l’a pas organisé ; et c’est à sa non-organisation, à l’état d’anarchie dans lequel il a été systématiquement laissé que doivent être attribués tous les désordres, toutes les violences auxquelles, du dedans et du dehors, il donne lieu ou sert de prétexte. Qui dit grève dit action ou inaction collective. On ne fait pas grève individuellement : un travailleur isolé qui se refuse au travail n’est pas un gréviste. La grève, c’est le refus collectif du travail, qu’il résulte des réclamations des salariés non satisfaits par les salariants ou des exigences des salariants non acceptées par les salariés. Elle est le droit collectif. (…)
... lorsque éclate un différend entre les ouvriers d’une usine, d’une concession minière, d’un chantier, et leurs employeurs, une réunion générale ait lieu de ces associés de fait dans le travail : travail commun, misère commune, ne permettant qu’une défense commune : que le cas leur soit soumis et qu’après délibération, si la grève est déclarée votée à bulletins secrets, elle devienne, de par la loi des majorités, obligatoire pour tous... La marche ou la continuation de la grève, du conflit désormais pacifique, sera réglée, comme sa fin, de la même façon, par le même procédé organique : la volonté de la majorité demandée au scrutin... » [32]
Il va sans dire que la proposition de Jules Guesde fut critiquée par certaines fédérations ouvrières, acceptée par d’autres et notamment par la Fédération des Mineurs.
Le projet Millerand donna lieu, quant à lui, à une circulaire de la Fédération des Bourses du travail en date du 21 mai 1901 :
« ...S’il plaît aux travailleurs d’organiser leurs grèves, de faire usage de referendum, libre à eux ; ils n’ont nullement besoin d’une loi réglementant, avec toutes sortes de complications, cette façon d’agir, d’une loi dont ils ne sont pas les auteurs, mais dont ils peuvent être les dupes et dont ils seront certainement les victimes. » [33]
Autre aspect des tentatives intégrationnistes, le premier projet que Waldeck Rousseau dépose en vue de la liberté d’association (il sera adopté, on le sait, deux ans plus tard : loi de 1901) prévoyait de donner la capacité commerciale aux syndicats ouvriers. (Cette disposition est reprise dans la proposition de loi que Millerand déposera le 12 juin 1906)
La fédération des Bourses s’insurge contre ce projet dont les visées ne lui échappent pas :
« La Fédération des Bourses du Travail, après avoir examiné les modifications à la loi du 21 mars 1884 proposées par le gouvernement, considérant :
1° que celles d’entre elles qui ont pour objet d’autoriser les syndicats à faire de leurs ressources un usage commercial auraient pour effet de dénaturer le rôle des organisations corporatives en y attirant les hommes exclusivement inspirés par l’esprit de lucre et en écartant ceux qui considèrent le syndicat comme devant être, avant tout, une société de résistance à l’exploitation capitaliste ;
2° que le droit d’ester en justice, accordé aux unions de syndicats, loin d’être pour elles un accroissement de liberté, est le meilleur moyen que puisse trouver le gouvernement de les frapper, puisque ce droit les soumettra à la réparation civile à laquelle elles échappent sous le régime actuel, et les contraindra ainsi, en cas de grève, à la neutralité ou à des poursuites dûment garanties par les saisies légales et partant ruineuses...
... La Fédération des Bourses demande le retrait pur et simple du projet de loi ; et, considérant que, dans l’état de lutte auquel l’inégalité économique réduit la classe ouvrière, celle-ci n’a nul souci de l’ordre social, réclame, avec l’abrogation des lois du 7 juin 1848 sur les attroupements, de 1872 contre l’Internationale et des articles 414 et 415 du Code pénal, la liberté complète de réunion et d’association. » [34]
Dans le journal, Le Mouvement socialiste de la première quinzaine de mars 1905, nous lisons encore, à propos du projet Millerand sur l’arbitrage que l’on tente de déterrer :
« Les 33 articles du projet adopté par la Commission de la Chambre, et qui sont le texte à peine amendé de M. Millerand, peuvent se résumer en ces trois propositions : 1° entraves à l’organisation syndicale par l’institution de délégués d’usine et la localisation des revendications ouvrières ; 2° délais d’atermoiements pour amortir le choc des explosions grévistes et parlementarisation du mouvement : en somme impossibilité pratique de la grève ; 3° arbitrage : celui-ci est une « guillotine sèche » et il a pour but de mettre fin aux rares grèves qui malgré tout auraient éclaté. » [35]
Dolléans précise encore :
« En 1905, comme en 1906 à Amiens et en 1908 à Marseille, le syndicalisme révolutionnaire est hostile à l’arbitrage obligatoire. Celui-ci est le plus sûr moyen d’entraver le développement spontané des grèves : « Plus de cette atmosphère de bataille qui, à l’heure présente, excite les ouvriers à défendre avec acharnement leurs intérêts... ; un néo-rondecuirisme va assagir le prolétariat. »
La réglementation de la grève est destinée à empêcher la grève d’abord, à l’étouffer ensuite... Le lotissement du pays industriel en infimes circonscriptions électorales, c’est la création d’un inévitable particularisme ouvrier, c’est la substitution des revendications d’usine et d’atelier aux revendications de classe ou seulement de corporation... « Les abstractions de la géographie politique remplacent les préoccupations démodées de conscience de classe et d’action autonome des minorités révolutionnaires. » En résumé, une irréductible opposition existe entre les méthodes de la démocratie économique, calquée sur celles de la démocratie politique et les conceptions du syndicalisme révolutionnaire : autonomie syndicale et action des minorités agissantes. » [36]
On le constate très nettement : les pionniers du syndicalisme résistent pied à pied à toutes les tentatives d’intégration et de soumission à l’État Bourgeois, tandis que l’opportunisme, le parlementarisme enveloppe et mine graduellement le mouvement socialiste qui peine à s’unifier.
Dans ces conditions, l’indépendance complète des syndicats à l’égard de l’État bourgeois et des capitalistes passe par l’indépendance à l’égard des partis ouvriers existants et du Parti socialiste qui va s’unifier dans la SFIO en 1905, ne serait-ce que dans la mesure où cette autodétermination des syndicats est gage d’unité des travailleurs, par-delà leurs différences idéologiques et politiques.
1906 : l’accélération
Fin avril 1905 se tient le congrès d’unification des forces socialistes, Salle du Globe, boulevard de Strasbourg, à Paris. Millerand est écarté du processus, ainsi que ses propositions d’unification sur la base de l’attachement à la patrie et de la perspective de la conquête légale du pouvoir, par les voies parlementaires.
Le congrès d’unité adopte la déclaration de principes suivante :
« Le Parti Socialiste est fondé sur les principes suivants : ![]() entente et organisation internationales des travailleurs
entente et organisation internationales des travailleurs ![]() organisation politique et économique du prolétariat en parti de classe pour la conquête du pouvoir et la socialisation des moyens de production et d’échange, c’est-à-dire la transformation de la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste » [37]
organisation politique et économique du prolétariat en parti de classe pour la conquête du pouvoir et la socialisation des moyens de production et d’échange, c’est-à-dire la transformation de la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste » [37]
Bien évidemment, cette déclaration ne fait pas du PS, un parti révolutionnaire, internationaliste et plus homogène mais, dans les conditions du moment, le PS est indiscutablement un point d’appui pour les classes laborieuses et l’affirmation du prolétariat comme classe révolutionnaire. C’est la représentation politique de la classe ouvrière, bien que déformée par l’adaptation croissante à la société bourgeoise et à ses institutions de ses dirigeants qui, tous (hormis Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914), sombreront dans l’Union sacrée chauvine de la Première guerre mondiale, pour le compte de l’impérialisme.
Précédemment, en 1902, la fondation de la CGT a été parachevée par l’intégration pleine et entière de la Fédération des bourses du travail, et l’adoption de statuts dont l’article 1er proclame :
La confédération générale du travail, régie par les présents statuts, a pour objet
1° Le groupement des salariés pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels ;
2° Elle groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du Salariat et du Patronat [38]
L’article 3 n’est pas sans importance. Il stipule en effet que :
Nul syndicat ne pourra faire partie de la confédération s’il n’est fédéré nationalement et adhérent à une Bourse du travail ou à une Union locale de syndicats locale, départementale ou régionale de corporations diverses
Le principe retenu est celui de la double-affiliation de chaque syndicat à une fédération de branche et à une union interprofessionnelle locale, départementale ou régionale. Cette double-affiliation est un garde-fou au verticalisme : le syndicat cloisonné dans sa branche et, de fait, perméable aux tentatives d’intégration néo-corporatiste
L’élan est donné : en 1902, 1 403 syndicats, 30 fédérations et 86 Bourses du travail sont affiliés à la CGT. En 1906, ce sont 2 399 syndicats, 52 fédérations et 109 Bourses du travail. Plus de 200 000 cotisants. Cet effectif sera multiplié par quatre au 1er janvier 1914 : 839 331 syndiqués sur 7 630 000 salariés de l’industrie. [39]
De 1902 à 1906, après une accalmie observée au cours de la période 1895/1900, la tendance à la grève s’accentue dans le pays. La grève de Montceau-les-Mines, en 1901 a inauguré ce nouveau cycle : grève longue. Les grévistes se battent contre la troupe. Condamnations et emprisonnements pleuvent. Les dirigeants réformistes, Basly au premier chef, tente d’étouffer la proposition de grève générale par une consultation-référendum. Or, le référendum se prononce pour la grève générale des Mines. De concert, dirigeants réformistes et gouvernement font miroiter des promesses qui permettent d’ajourner la grève générale. Promesses non tenues. 1800 mineurs sont révoqués. Mais, en 1902, le congrès national des mineurs appelle à la grève générale contre la réduction des primes sur salaire. En réaction, le gouvernement procède à l’occupation militaire des Mines du nord. Ce faisant, Jaurès et Basly, de concert, pressent le gouvernement de procéder à l’arbitrage. Sur les conseils de leurs dirigeants, les mineurs acceptent l’arbitrage qui, comme on pouvait s’y attendre, est un nœud coulant. La grève est défaite.
C’est à la suite de cette trahison que, un an plus tard, Benoît Broutchoux, anarchiste valeureux, impulse le « jeune syndicat » face au « vieux syndicat réformiste » des « baslycots » dans les Mines.
En 1904, c’est la grève générale du textile rouannais soutenue par 5000 grévistes. Le Maire et l’adjoint au Maire, ceints de leur écharpe tricolore s’opposent à l’entrée de la troupe dans la ville. Les grévistes obtiendront satisfaction partielle de leurs exigences.
Et, le 10 Mars 1906, survient la terrible catastrophe minière de Courrières. 1200 tués ! Dans les jours qui suivent, un mouvement de grève et de révoltes spontanées submerge les cadres syndicaux réformistes. Le Jeune syndicat propose au syndicat réformiste l’unité par un comité de grève. Les réformistes jetant l’exclusive sur Broutchoux, se défaussent. Après avoir louvoyé, Georges Clémenceau, ministre de l’Intérieur, fait donner la troupe qui envahit le bassin minier tandis que Broutchoux et Monatte sont arrêtés puis accusés d’avoir été financés par d’obscurs bonapartistes pour fomenter un complot antirépublicain. Une fois encore, la grève est conduite à l’échec par Basly et ses affidés.
Le 30 avril, Victor Griffuelhes est à son tour arrêté. Mais, l’action du 1er mai pour l’obtention des 8 heures (au cours de la grève des mineurs, le mot d’ordre lancé par Broutchoux était « huit heures, huit francs ») n’est pas enrayée pour autant.
« A Paris et dans certaines villes, des manifestations imposantes ont lieu, relate Dolléans. De nombreux travailleurs y participent. Nombreuses sont aussi les grèves qui éclatent le 2 mai. La grève de la Fédération du Livre avait commencé le 18 avril ; puis, à partir du 25 avril et du 2 mai, une vingtaine de corporations et 150 000 ouvriers suivent le mouvement. En outre, dans la Métallurgie, pour le département de la Seine, 50 000 ouvriers font grève. » [40]
Le Congrès d’Amiens :
Revenons maintenant à nos actuels détracteurs anti-Charte dans le NPA et à la Charte d’Amiens elle-même. Ils écrivent à ce sujet :
« Face à ce bloc anarcho-réformiste, il y eut donc les guesdistes. On en dit souvent grand mal, et c’est un fait que les élaborations de Guesde furent bien souvent critiquables. Pourtant, à la lecture des débats du congrès, de la motion soumise au vote, on se demande bien ce qu’un marxiste aurait pu en critiquer. . Ce qui sous-tend la motion guesdiste, c’est de « s’entendre toutes les fois que les circonstances l’exigeront, soit par des délégations intermittentes, ou permanentes avec le Conseil national du Parti socialiste pour faire plus facilement triompher ces principales réformes ouvrières. »
Ce qui est inattaquable d’un point de vue marxiste. » [41]
La motion Renard
La Charte d’Amiens fut adoptée à l’issue d’un débat au cours du Congrès de la CGT d’octobre 1906 sur les rapports entre les syndicats et les partis politiques. De fait, cette discussion a été introduite par Victor Renard, secrétaire de la Fédération Textile qui a donc déposé la motion suivante, dont un extrait seulement a été cité par les anti-Charte. La voici dans son intégralité :
« Considérant qu’il y a lieu de ne pas se désintéresser des lois ayant pour but d’établir une législation protectrice du travail qui améliorerait la condition sociale du prolétariat et perfectionnerait ainsi les moyens de lutte contre la classe capitaliste ;
« Le Congrès invite les syndiqués à user des moyens qui sont à leur disposition en dehors de l’organisation syndicale afin d’empêcher d’arriver au pouvoir législatif, les adversaires d’une législation sociale protectrice des travailleurs ;
« Considérant que des élus du parti socialiste ont toujours proposé et voté les lois ayant pour objectif l’amélioration de la condition de la classe ouvrière ainsi que son affranchissement définitif ;
« Que tout en poursuivant l’amélioration et l’affranchissement du prolétariat sur des terrains différents, il y a intérêt à ce que des relations s’établissent entre le Comité confédéral et le Conseil national du Parti socialiste par exemple pour la lutte à mener en faveur de la journée de huit heures, de l’extension du droit syndical aux douaniers, facteurs, instituteurs et autres fonctionnaires de l’Etat ; pour provoquer l’entente entre les nations et leurs gouvernements pour la réduction des heures de travail, l’interdiction du travail de nuit des travailleurs de tout sexe et de tout âge ; pour établir le minimum de salaire, etc., etc.
« Le Congrès décide :
« Le Comité confédéral est invité à s’entendre toutes les fois que les circonstances l’exigeront, soit par des délégations intermittentes, ou permanentes avec le Conseil national du Parti socialiste pour faire plus facilement triompher ces principales réformes ouvrières.
« Mandat est donné aux délégués de la Fédération textile qui la représenteront au Congrès confédéral d’Amiens de soutenir ladite résolution
». [42]
On le voit, ce n’est pas un appel à une simple liaison mais une résolution qui prône la solidarité politique et électorale avec le parti socialiste et appelle donc, implicitement certes, mais nettement, au vote PS aux diverses élections. D’un point de vue marxiste, l’idée de « poursuivre l’amélioration et l’affranchissement du prolétariat sur des terrains différents » n’est-elle pas équivoque ? Le terrain parlementaire, par exemple, est-il un terrain sur lequel on peut poursuivre « l’amélioration et l’affranchissement du prolétariat » ? Et, le terrain électoral ? Il s’agit, les marxistes l’ont toujours rappelé, de terrains déformés de la lutte des classes que les militants se doivent d’utiliser sans réserve… ni illusions, comme points d’appuis à la mobilisation des masses pour arracher droits, garanties collectives, lois protectrices, salaires décents et à la centralisation du combat dans la voie du gouvernement ouvrier. Sinon, c’est exactement ces camarades anti-Charte appellerait du réformisme : par l’action parlementaire routinière et l’action syndicale « étroitement revendicative », petit à petit, l’oiseau fait son nid dans les combles du vieux monde et, graduellement, de lois sociales en contrats collectifs, on passe en douceur du capitalisme au socialisme. Mais, en admettant même que la motion Renard fut inattaquable du point de vue marxiste, si l’on considère ce texte de façon intemporelle, en dehors du contexte où il apparaît, il reste que le marxisme recherche en permanence le concret et ne se gausse pas des particularités de développement du phénomène considéré. Les rapports syndicats-parti ne sont pas donnés une bonne fois pour toutes et de la même façon dans les divers pays. On ne peut pas les considérer indépendamment de leur histoire particulière.
Nos mêmes camarades nous disent : On sait qu’au tournant du XX° siècle, le marxisme n’avait pas encore acquis la suprématie dont il bénéficiait dans un pays comme l’Allemagne. Le réformisme fut toujours très fort (voir l’influence possibiliste, jaurésienne, etc.) au sein du mouvement socialiste. Ce n’est pas un hasard si c’est en France qu’apparut le « ministérialisme », orientation qui justifiait l’entrée d’un socialiste, Millerand, dans un gouvernement bourgeois (1899).
Et ce n’est pas un hasard si le marxisme ne se développe pas « comme il faut » en France. Tout d’abord, il y a le retard de la concentration industrielle en France par rapport à l’Allemagne ou l’Angleterre, le poids spécifique d’ouvriers qui se détachent à peine de l’artisanat. Cette configuration explique l’implantation de courants anarchistes et anarchisants sur fond d’individualisme. Ensuite, l’écrasement de la Commune de 1871 qui oblige les ouvriers conscients à « tout recommencer ». Mais, ces constatations n’expliquent pas tout. Nos détracteurs nous disent : « Les marxistes étaient quant à eux organisés au sein du Parti Ouvrier Français de Guesde et Lafargue, et dont Marx avait rédigé le programme. Mais le POF ne put jamais s’assurer de positions dominantes au sein du mouvement ouvrier. » Or, nous venons de voir que le PO (devenu POF en 1893 par adaptation au chauvinisme) a dirigé la Fédération des syndicats au moment où n’existait pas encore la fédération des Bourses du travail. Partant, ils ont multiplié erreurs et faux pas, mésintelligence avec les blanquistes, avec les syndicalistes-révolutionnaires, leur sectarisme n’empêchant pas les glissements opportunistes, comme celui consistant à proposer une réglementation des grèves au Parlement. Tous ces errements, là où les efforts patients, tenaces auraient dû être consentis pour convaincre, non par les ultimatums bureaucratiques, mais par l’explication patiente, ces militants syndicalistes révolutionnaires, anars ou non, au lieu de se braquer de façon quasi puérile sur la question de la Grève générale, de se tenir en dehors de la formation de la CGT.
Aussi bien , pour revenir à la motion Renard invitant la CGT à se solidariser avec le PS, le moins que l’on puisse en dire est qu’elle ne tient pas compte du fait qu’un pan entier de la CGT est influencé par les anarchistes de diverses obédiences Et qu’il y a effectivement , par ailleurs, des réformistes partisans de la neutralité du syndicat sur toute question politique, proches effectivement des ministérialistes (ce qui ne les empêche pas de s’inscrire dans les grèves, comme l’a montré l’action de la fédération du Livre, tenue par les réformistes, à la veille du 1er mai) . Ce qui procure alors la désagréable impression que la motion Renard fut une manœuvre de mise au pied du mur de la jeune CGT.
Encore une fois, la question n’est pas, ou n’était pas, de dire, comme dans un référendum, oui ou non au rapprochement de la CGT avec le Parti socialiste. Ce qui fut en cause, ce fut, on peut le penser, le caractère exclusif et définitif de ce rapprochement, étant entendu qu’une partie des auteurs de la Charte d’Amiens étaient membres du PS.
Le problème est de savoir si on est pour ou contre l’autonomie, l’indépendance pour être précis, des syndicats. Eh bien, en toute logique, les anti-Charte sont tout simplement contre.
A l’appui de leurs thèses, ils se réfèrent au congrès socialiste international de 1907 à Stuttgart qui aborda la question des rapports syndicats-parti. La résolution « sur les rapports du Parti socialiste et les syndicats » plaide en effet en faveur de la coopération entre le Parti et les syndicats :
« Pour affranchir entièrement le prolétariat du servage intellectuel, politique et économique, la lutte politique et la lutte économique sont également nécessaires. Si l’activité du Parti socialiste s’exerce surtout dans le domaine de la lutte politique du prolétariat, celle des syndicats s’exerce principalement dans le domaine de la lutte économique de la classe ouvrière. Le Parti et les syndicats ont une besogne également importante à accomplir.
Chacune des deux organisations a son domaine distinct déterminé par sa nature et dans lequel elle doit régler son action d’une façon absolument indépendante. Mais il y a aussi un domaine toujours grandissant de la lutte des classes prolétarienne, dans lequel on ne peut obtenir davantage que par l’accord et la coopération du Parti et des syndicats. Par conséquent, la lutte prolétarienne sera d’autant mieux engagée et d’autant plus fructueuse, que les relations entre les syndicats et le Parti seront plus étroites, sans compromettre la nécessaire unité du mouvement syndical » [43]
A tout le moins, cette résolution est plus nuancée que ne le soutiennent nos « anti » et porte mention de l’indépendance réciproque syndicats-parti. Y compris, le passage de Lénine que citent nos camarades dans leurs textes anti-Charte n’a rien à voir avec le caractère bureaucratique-ultimatiste de la motion guesdiste. Reprenons-là :
« La majorité de la délégation française s’employèrent à l’aide d’arguments assez malheureux à justifier une certaine limitation de ce principe en se référant aux particularités de leur pays. Mais l’écrasante majorité du congrès se prononça pour une politique résolue d’union de la social-démocratie et des syndicats... la question s’est trouvée, au fond, posée de la façon suivante : neutralité ou relations toujours plus étroites des syndicats avec le parti ? Le congrès socialiste international (...) s’est prononcé en faveur du rapprochement entre les syndicats et le parti(…) En évitant toute imprudence, toute précipitation et tout faux pas tactique, nous devons travailler inlassablement au sein des syndicats afin de les rapprocher sans cesse du parti social-démocrate ».
Pas de précipitation, pas de faux-pas tactique mais un travail inlassable et vivant qu’aucune motion ne peut remplacer.
En tout état de cause, la motion Renard fut rejetée par une majorité plus qu’écrasante au cours d’une discussion passionnante sur la place et le rôle du syndicalisme, son indépendance, son unité et son caractère de classe.
Nous allons nous efforcer d’en retracer les moments les plus intenses.
L’intervention de Niel
Parmi les réponses les plus marquantes à Renard, figure indiscutablement celle de Niel :
D’abord, qu’est-ce que le syndicalisme ?
On peut dire que le syndicalisme est une forme d’action employée par des malades contre le mal, plus exactement par les ouvriers contre les patrons. Le mal, c’est les patrons, c’est-à-dire le patronat, le capitalisme et tout ce qui en découle. Les malades, ce sont les ouvriers. Or, comme on est ouvrier avant d’être citoyen, on trouve chez le salarié l’individu économique avant l’individu politique. Ce qui fait que si sur le terrain politique tous les citoyens politiques ne se ressemblent pas encore, sur le terrain économique tous les ouvriers se ressemblent déjà. Et cela explique que si l’union de tous les citoyens est encore très difficile, l’association de tous les ouvriers est très possible.
Je m’excuse d’avoir l’air de faire un cours de syndicalisme à des militants qui en savent tous autant que moi. Mais l’occasion est trop belle pour que chacun ici, n’essaie pas de faire comprendre de quelle façon il conçoit le syndicalisme, avec sa forme particulière et ses arguments particuliers.
Le mal dont souffrent tous ces malades, c’est l’injustice sociale qui découle de l’exploitation de l’homme par l’homme, base du régime capitaliste. Ce mal frappe tous les ouvriers d’une façon égale.
Quand un patron veut diminuer les salaires à ses ouvriers, il ne les diminue pas d’un sou à ses ouvriers réactionnaires, de deux sous aux républicains, de trois sous aux socialistes, de quatre sous aux anarchistes, de cinq sous aux croyants, de six sous aux athées, etc. Il les diminue d’une façon égale à tous ses ouvriers, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses, et c’est cette égalité dans le mal qui les atteint, qui leur fait un devoir de se solidariser sur un terrain où les différences politiques ou religieuses ne les empêcheront pas de se rencontrer. Ce terrain, c’est tout simplement le syndicalisme, puisque aussi bien le syndicalisme a pour objet de s’occuper de la question des salaires.
Une fois réunis sur ce terrain de neutralité absolue, les ouvriers lutteront ensemble pour résister à une baisse des salaires ou pour en obtenir une hausse ; pour résister à toute augmentation de la journée de travail ou pour en obtenir une diminution ; pour faire obtenir des règlements d’atelier ou des conditions de travail donnant plus de bien-être et plus de liberté ; pour faire respecter leur dignité toujours menacée par l’arrogance de ceux qui ont un coffre-fort dans la tête à la place du cerveau. Enfin, comme cette lutte leur permettra de voir bientôt l’antagonisme irréductible qui sépare les exploiteurs des exploités, l’impossibilité d’en finir jamais si ça ne change pas, ils orienteront leurs luttes vers une transformation sociale, ce qui leur permettra de mettre dans leurs statuts généraux : « Suppression du salariat et du patronat ».
L’action syndicale est donc celle qui s’exerce sur le terrain économique, par tous les ouvriers, contre le mal économique. Ce n’est pas autre chose que l’action directe sous toutes ses formes et tous ses caractères de calme ou de bruit ; de modération ou de violence ; c’est la pure lutte de classes. (…)
[44]
La motion réformiste de Keufer
Et puisque nos « anti » indépendance syndicale croient qu’il y eut alliance entre réformistes et syndicalistes-révolutionnaires contre les marxistes et Renard, il convient de reproduire ici la motion d’Auguste Keufer, dirigeant de la Fédération du Livre et qui avait, en son temps, soutenu l’entrée de Millerand au gouvernement :
« Le Congrès confédéral réuni à Amiens,
« Considérant :
« Que dans l’intérêt de l’union nécessaire des travailleurs dans leurs organisations syndicales et fédérales respectives, et pour conserver le caractère exclusivement économique de l’action syndicale, il y a lieu de bannir toutes discussions et préoccupations politiques, philosophiques et religieuses du sein de l’organisme confédéral.
« Que la Confédération générale du travail, organe d’union et de coordination de toutes les forces ouvrières, tout en laissant à ses adhérents entière liberté d’action politique hors du syndicat, n’a pas plus à devenir un instrument d’agitation anarchiste et anti-parlementaire, qu’à établir des rapports officiels ou officieux, permanents ou temporaires, avec quelque parti politique ou philosophique que ce soit ;
« Affirme que l’action parlementaire doit se faire parallèlement à l’action syndicale, cette double action pouvant contribuer à l’œuvre d’émancipation ouvrière et à la défense des intérêts corporatifs
. »
P Coupat, Fédération des Mécaniciens ; A. Keufer. Fédération du Livre ; L. Malardé, Fédération des Tabacs ; H. Sellier, Fédération des Employés, Bourse du Travail de Puteaux ;E. Guernier, Bourse du Travail de Reims ; L. Rousseau, Employés Reims, Châlons-sur-Marne ; Limousin, Bourse du Travail de Poitiers ; Liochon, Livre ; Masson, Typographes de Lille ; Hamelin, Livre ; Sergent, Typographie parisienne ; Jusserand, Typographie parisienne ; Richard, Teinturiers de Reims ; Richon, Bourse du Travail d’Epernay ;Thévenin, Comptables de Paris ; Traut, Bourse de Belfort ; Valentin, Typos de Montpellier. [45]
La réponse de Griffuelhes
La réponse de Victor Griffuelhes, secrétaire général de la CGT, est on ne peut plus ferme :
Griffuelhes : Les reproches formulés, dit-il, portent sur la méthode et l’esprit de la C.G.T. Il faut donc insister sur le caractère de son mouvement.
Et d’abord, constatons que Merrheim a détruit par des chiffres, la base de l’exposé de Renard ; il a prouvé que la méthode qu’il préconise n’a pas donné de grands résultats, attendu l’inexactitude des chiffres produits. Et qu’on ne nous dise pas que les syndicats jaunes sont peu importants et ne rentrent pas pour une grosse part dans les chiffres que vous avez donnés. Il y a plusieurs syndicats jaunes en dehors de Roubaix qui comprennent chacun plus d’un millier de membres ; à Lille, il y en a deux, à Armentières, etc. En outre, dans le Nord, il faut distinguer plusieurs régions : Lille, Roubaix, Tourcoing, le Cambrésis, d’un côté. Mais Dunkerque et Valenciennes échappent à l’influence des amis de Renard. Donc, de ce fait, les chiffres avancés diminuent encore de valeur.
Si encore vous aviez apporté la preuve d’immenses résultats. Mais non ! Grâce à vos chiffres faux, on serait en droit de conclure que votre œuvre s’évanouit presque.
Et puis, vous citez les Anglais, nous disant qu’après 50 ans d’action directe, ils viennent au Parlementarisme. Vous ajoutez qu’ils ont les plus hauts salaires et les plus courtes journées. Cela, c’est le résultat de leur action directe. Quant aux effets du parlementarisme chez eux, le moins est d’attendre pour les enregistrer. Il y a donc là une contradiction qui se retourne contre vous.
Vous prétendez que ce que vous demandez existe déjà, sous forme de rapports occultes entre la C.G.T. et les parlementaires, C’est inexact ! En deux circonstances, j’ai eu des rapports personnels avec deux députés, Sembat et Wilm. Ils m’avaient demandé de les documenter pour interpeller. Je l’ai fait et chaque fois qu’un député, répondant à la mission qu’il s’est donné, voudra se renseigner, je le documenterai avec plaisir. Mais, en ces circonstances, ces députés ne faisaient que leur devoir et il n’y a pas à leur en avoir gratitude.
Au-delà de la proposition de Renard, qui pose une question de fait, il en est une plus importante, celle de Keufer, qui, parlant d’unité morale, reproche à la C.G.T. de l’avoir détruite.
Cette unité morale ne peut exister. Dans tout groupement il y a lutte et non division. L’acceptation de son ordre du jour constituerait une négation de la vie, qui est faite du choc des idées.
De plus, Keufer insiste trop sur la présence des libertaires au sein du Comité confédéral ; ils n’y sont pas aussi nombreux que le veut la légende. Mais, c’est une tactique pour faire surgir un péril libertaire, afin de constituer un bloc pour annihiler ce péril. Au lieu de vagues affirmations, il fallait produire des faits, des résolutions, des documents émanant de la C.G.T. et inspirés par l’unique objectif anarchiste. Il n’y en a pas ! Qu’il y ait chez certains d’entre nous des idées libertaires, oui ! Mais qu’il en naisse des résolutions anarchistes, non !
Coupât a dit qu’avant 1900, la C.G.T. n’avait pas prêté le flanc aux critiques. Oui, parce qu’elle n’existait pas. Il a ajouté que l’entrée de Millerand au ministère a donné naissance à cet esprit. Rappelons des faits peu connus :
A peine Millerand ministre, parut une déclaration signée de Keufer, Baumé, Moreau, en faisant suivre leur nom de leur qualité de secrétaire d’organisation, etc., approuvant son acte. Est-ce que pareille déclaration ne constituait pas un acte politique ? Et quel pouvait en être le résultat ? Puis, à l’Union des Syndicats de la Seine, on vint proposer un banquet à Millerand. N’était-ce pas encore un acte politique pour un but bien défini ? Seul, je m’y opposai. On manœuvrait alors pour introduire l’influence du gouvernement au sein de la Bourse du Travail, et c’est en réaction à cette tendance qu’est venu l’essor de la C.G.T.
Au lendemain de Chalon, les membres de la Commission de la Bourse du Travail reçurent, pour eux et leurs familles, une invitation à une soirée du ministre du commerce ; deux jours après, nouvelle invitation, de Galliffet celle-là ! pour un carrousel.
Que voulait-on ? Nous domestiquer ! Nous fûmes deux à protester et à propagander contre. Nous dévoilâmes ces manœuvres et, petit à petit, nous finîmes par faire voir clair aux camarades.
L’explosion de vitalité de la C.G.T. résulte de ces événements. Il y eut une coalition d’anarchistes, de guesdistes, de blanquistes, d’allemanistes et d’éléments divers pour isoler du pouvoir les syndicats. Cette coalition s’est maintenue, elle a été la vie de la Confédération. Or, le danger existe encore. Il y a toujours des tentatives pour attirer au pouvoir les syndicats, et c’est cela qui empêchera l’unité morale.
Où l’unité morale peut se faire, c’est si on cherche à la réaliser contre le pouvoir et en dehors de lui. Or, comme il en est qui sont pour ces contacts, ceux qui s’opposent à ces relations empêcheront l’unité morale dont parle Keufer.
Ce qu’il faut voir, c’est que ce n’est pas l’influence anarchiste, mais bien l’influence du pouvoir, qui entraîne à la division ouvrière.
Exemple, les mineurs. La désunion ouvrière fut la conséquence de la pénétration du pouvoir. En 1901, on s’opposa à la grève pour ne pas le gêner et pour ne pas contrarier l’œuvre « socialiste » de Millerand-Waldeck-Rousseau. Joucaviel, qui avait tout fait pour s’opposer à la grève, a reconnu, après quatre ans, que le pouvoir n’avait pas tenu les promesses faites, que le gouvernement avait roulé les mineurs.
Est-ce les anarchistes de la C.G.T. qui ont créé ce conflit ? Non ! Pas plus qu’ils n’ont créé celui des Travailleurs municipaux.
En ce qui concerne ceux-ci, le conflit a son origine entre ceux qui voulaient que l’organisation marche à la remorque de l’administration et ceux qui s’y opposaient.
En réalité, d’un côté, il y a ceux qui regardent vers le pouvoir et, de l’autre, ceux qui veulent l’autonomie complète contre le patronat et contre le pouvoir. C’est en ce sens que s’est manifestée l’action de la C.G.T., et le développement considérable qui en a été la conséquence infirme la thèse du Textile : l’accroissement de la Confédération a été parallèle à l’accentuation de sa lutte. Il n’y a donc pas nécessité de modifier un organisme qui a fait ses preuves ; mais au contraire, de déclarer que la C.G.T. doit rester telle que ces dernières années.
Admettons que la proposition du Textile soit votée ! Elle créerait des rapports entre la C.G.T. et le Parti. Or, qui dit rapport, dit entente ; qui dit entente, dit accord ! Comment s’établirait cet accord fait de concessions mutuelles, entre un Parti qui compte avec le pouvoir, car il en subit la pénétration, et nous qui vivons en dehors de ce pouvoir. Nos considérations ne seraient pas toujours celles du Parti, d’où impossibilité matérielle d’établir les rapports demandés
.
De même qu’il faut repousser l’ordre du jour du Textile, de même il faut repousser celui du Livre qui voudrait limiter l’action au rayon purement corporatif et nous ramener au trade-unionisme anglais. Ce serait rétrécir le cadre de l’action syndicale et lui enlever toute affirmation de transformation sociale. Le Congrès ne voudra pas cela. Ce serait méconnaître le processus historique de notre mouvement. Ce serait une reculade et ce n’est pas au moment où il y a accentuation d’action qu’il pourrait y avoir reculade de principe. » [46]
C’est clair, c’est net : les auteurs de la Charte d’Amiens, au premier rang desquels se trouve Griffuelhes, n’étaient pas adeptes de la neutralité politique. Ni partisans de bannir toute discussion et préoccupation politique dans le syndicat. Ainsi, l’antimilitarisme de la CGT ne découle pas d’une conception politique d’ensemble, libertaire ou marxiste, mais se développe parce que l’armée intervient contre les grévistes, parce que le danger de guerre se rapproche à grand pas depuis 1905 et parce que la conscription rend nécessaire la défense des jeunes soldats qui « sous l’uniforme, restent des travailleurs ». C’est dire que les prises de position politique du syndicat se développent à partir des besoins de l’action syndicale, des obstacles qu’elle rencontre et non à partir d’un programme politique déterminé. En substance, le syndicat est un groupement d’intérêts et non d’opinions.
La Charte d’Amiens
Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la C.G.T.
« La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat... ;
« Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière ;
« Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique :
« Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. ;
« Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance sera, dans l’avenir, le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale ;
« Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait de tous les travailleurs quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat ;
« Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors ;
« En ce qui concerne les organisations, le Congrès décide qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté, la transformation sociale. » [47]
Marie ; Cousteau ; Menard ; Chazeaud ; Bruon ; Ferrier ; E. David, B. d.T. Grenoble ; Latapie ; Médard ; Merrheim ; Delesalle ; Bled ; Pouget ; E. Tabard ; A. Bousquet ; Monclard ; Mazau ; Braun ; Garnery ; Luquet ; Dret ; Merzet ; Lévy ; G. Thil ; Ader ; Yvetot ; Delzant ; H. Galantus ; H. Turpin ; J. Samay, Bourse de Paris ; Robert ; Bornet ; P. Hervier, Bourse du Travail de Bourges ; Dhooghe, Textile de Reims ; Rouiller, Bourse du Travail de Brest ; Richer, Bourse du Travail du Mans ; Laurent, Bourse du Travail de Cherbourg ; Devilar, Courtiers de ?Paris ; Bastion, Textile d’Amiens ; Henriot, Allumettiers ; L. Morel, de Nice ; Sauvage ; Gauthier.
Première remarque : parmi les signataires de la Charte, pas de « réformistes »
Deuxième remarque : le compte-rendu sténographique fait état du vote de la Fédération du Livre « avec réserves » : « Jusserand fait la déclaration suivante au nom du Livre. Nous voterons la proposition Griffuelhes en faisant toutes nos réserves sur la grève générale, étant donné que le Livre y est momentanément hostile, parce qu’elle condamne l’intrusion de toute politique dans les syndicats et au sein de la C.G.T. »
Ainsi s’effondre la thèse (qui est aussi celle de certains anars, ceux de la CNT-AIT) d’une soi-disant alliance entre syndicalistes-révolutionnaires et réformistes scellant une Charte de compromis.
En effet, contrairement à ce qu’avancent bien à tort et contre la réalité historique nos « anti », nous pouvons dire, document à l’appui, que la Charte d’Amiens ne met pas la politique hors le syndicat. Certes, la Charte « demande » aux syndiqués de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe en dehors, c’est-à-dire de ne pas utiliser le syndicat comme tribune, pour que le syndicat ne devienne pas un champ de bataille idéologique entre anarchistes et socialistes, par exemple. Puisque le syndicat doit se fonder sur la défense des intérêts immédiats. Les discussions politiques éventuelles découlant de la logique de défense des intérêts moraux et matériels : salaires, temps de travail. L’apolitisme, façon Charte d’Amiens, n’est pas la « neutralité », ni le refus de toute prise de position politique. Les réformistes ne s’y trompent pas : la référence explicite à la grève générale est une position politique. En l’occurrence, la grève générale n’est-elle pas « une opération politique par excellence » ainsi que l’a noté Trotsky plus tard, à propos de la France ?
Curieusement, ce sont les guesdistes (encore eux !) qui prétendent que le syndicat ne doit pas aller au-delà de la sphère revendicative et corporative dans laquelle il doit rester confiné et s’atrophier, dans le cadre d’une division des tâches : les tâches économiques prosaïques (ingrates) vont au syndicat et les tâches politiques (nobles) au parti, sans recouvrement possible. Le seul acte politique du syndicat consistant à voter pour ceux qui, au Parlement, proposeront des réformes favorables aux masses laborieuses.
Là où la Charte dit que les organisations confédérées n’ont pas, en tant que groupements syndicaux à se préoccuper des partis et des sectes, nos « anti-Charte » entendent, ils l’ont écrit, « refus par principe de l’unité parti-syndicat contre le Capital – ce qu’on appelle de nos jours le Front Unique. » Cela n’a pourtant strictement rien à voir avec la question de l’action commune. Cela veut simplement dire que le syndicat ne se préoccupe pas des prises de position de tel ou tel groupement politique. Ni plus, ni moins. Il faut quelquefois bien lire et relire…
Entre parenthèses : heureusement que la CGT ne s’est pas « préoccupée » de la position prise, en 1910, (malgré les protestations de Guesde et Lafargue) par le PS en faveur des retraites par capitalisation, à laquelle, fort justement, la CGT, criant à l’escroquerie, opposait : la répartition !
Redisons-le : dans le contexte de l’époque (et aujourd’hui encore compte-tenu du degré de dégénérescence et de décomposition des vieux partis ouvriers, PS et PCF) l’indépendance des syndicats à l’égard de l’Etat passait par l’indépendance à l’égard du Parti socialiste. Griffuelhes est dans le vrai lorsqu’il déclare : « Admettons que la proposition du Textile soit votée ! Elle créerait des rapports entre la C.G.T. et le Parti. Or, qui dit rapport, dit entente ; qui dit entente, dit accord ! Comment s’établirait cet accord fait de concessions mutuelles, entre un Parti qui compte avec le pouvoir, car il en subit la pénétration, et nous qui vivons en dehors de ce pouvoir »
En 1920, Trotsky se fera l’écho de cette appréhension :
« Avant-guerre, le parti socialiste français se présentait comme, dans ses sommets, comme l’expression la plus complète et la plus achevée de tous les côtés négatifs de la II ème Internationale : aspiration permanente à la collaboration de classes (nationalisme, participation à la presse bourgeoise, vote des crédits et de la confiance à des ministères bourgeois, etc.), attitude dédaigneuse ou indifférente à l’égard de la théorie socialiste ; c’est-à-dire des tâches fondamentales socialistes-révolutionnaires de la classe ouvrière, respect superstitieux des idoles de la démocratie bourgeoise (la République, le Parlement, le suffrage universel, la responsabilité ministérielles, etc.), internationalisme ostentatoire et purement décoratif joint à une extrême médiocrité nationale et souvent à un grossier chauvinisme » [48]
A la suite de cette condamnation sans appel du PS d’avant 14, Trotsky devait donner son point de vue sur les syndicalistes-révolutionnaires :
« La forme la plus éclatante de protestation contre ces aspects du parti socialiste fut le syndicalisme révolutionnaire français. Comme la pratique du réformisme et du patriotisme parlementaire se dissimulait derrière les débris d’un pseudo-marxisme, le syndicalisme s’efforçait d’étayer son opposition au réformisme parlementaire par une théorie anarchiste adaptée aux formes et aux méthodes du mouvement syndical de la classe ouvrière.
La lutte contre le réformisme parlementaire devenait ainsi une lutte non seulement contre le parlementarisme, mais contre la « politique » en général, une pure négation de l’Etat en tant que tel. On proclamait que les syndicats étaient la seule forme révolutionnaire légitime et authentique du mouvement ouvrier. A la représentation de type parlementaire, au fait de substituer dans les coulisses, à la classe ouvrière, des éléments qui lui étaient étrangers, on opposait l’action directe des masses ouvrières, on attribuait le rôle décisif à la minorité d’initiative en tant qu’organe de cette action directe.
Cette brève caractérisation du syndicalisme montre qu’il s’efforçait de devenir une expression aux besoins de l’époque révolutionnaire qui approchait. Mais des erreurs théoriques fondamentales – celles de l’anarchisme- rendaient impossible la création d’un solide noyau révolutionnaire, bien soudé idéologiquement et capable de résister effectivement aux tendances patriotiques et réformistes »
Syndicalisme et communisme
Soucieux de démontrer que « le contenu et la méthode de la Charte d’Amiens s’opposent aux méthodes et aux conclusions de tous les théoriciens du socialisme », nos anti-Charte dans le NPA considèrent que la Charte d’Amiens s’oppose à la création de fractions communistes dans les syndicats. Ils opposent alors l’esprit et la lettre de la Charte à la perspective de « conquérir les syndicats au communisme ».
Rappelons que la Charte reprend l’article 2 des statuts de la CGT qui revendique « la disparition du Salariat et du Patronat », ce qui nous mène au seuil du communisme, non ?
La Charte qui réaffirme cet article des statuts est une déclaration de reconnaissance de la lutte des classes. Nous ne sommes pas si loin du communisme, au sens large, bien sûr. Au sens où Lénine le présente dans « l’Etat et la Révolution » : « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Lénine qui, nous le verrons plus loin, appréhende le syndicat comme « une école du communisme et de la révolution ».
La Charte, que nos amis caractérisent comme un document réformiste, prône « l’expropriation capitaliste ». C’est déjà du socialisme brut de décoffrage. Non ? Par comparaison, la déclaration de principe de la SFIO de 1905 (voir plus haut) n’est pas aussi explicite.
La Charte qui n’est pas un évangile n’a pas anticipé sur la faillite de la deuxième internationale en 1914 et la victoire de la Révolution Russe en Octobre 1917. La Charte n’a pas anticipé la trahison de la direction confédérale, en 1914 puis au cours des grèves de 1920…C’était du domaine de l’impossible (Lénine non plus n’a pas vu venir le 4 août 1914, c’est-à-dire le vote des crédits de guerre par les députés sociaux-démocrates allemands).
Et, surtout, il importe de rappeler que les dirigeants bolcheviks n’étaient pas omniscients et qu’ils ne formaient pas non plus une entité monolithique. Confère le débat qui, en 1921, mit aux prises Lénine, Trotsky et Boukharine. Débat au cours duquel il apparut clairement que Lénine, lui, ne mettait pas l’indépendance syndicale entre guillemets, bien au contraire.
1920-1921 : Lénine, les syndicats et l’Etat ouvrier
Trotsky considérait, de prime abord, que le rôle des syndicats dans un Etat ouvrier comme la Russie soviétique n’était plus de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Selon Trotsky, le rôle et la place du syndicat était désormais celui d’un appareil administratif et technique chargé de gérer la production.
Lénine, marquant son désaccord avec cette approche, devait lui répondre :
« Les syndicats ne sont pas seulement l’organisation historiquement nécessaire du prolétariat industriel, ils en sont encore l’organisation historiquement inévitable, et, sous la dictature du prolétariat, ils l’englobent dans sa totalité. (…) Il découle de ce que je viens de dire que, dans l’exercice de la dictature du prolétariat, le rôle des syndicats est absolument capital. Mais en quoi consiste ce rôle ? L’examen de cette question, une des questions théoriques majeures, m’amènent à conclure que ce rôle est extrêmement original.
D’une part, les syndicats groupent, englobent la totalité des ouvriers de l’industrie : ils sont de ce fait une organisation de la classe dirigeante, dominante, de la classe au pouvoir qui exerce la dictature, exerce la contrainte étatique. Mais, ce n’est pas une organisation d’Etat, coercitive ; son but est d’éduquer, d’entraîner, d’instruire, c’est une école, une école de direction, une école de gestion, une école du communisme. (…) Dans le système de la dictature du prolétariat, les syndicats se situent, si l’on peut s’exprimer ainsi, entre le Parti et le pouvoir d’Etat. La dictature du prolétariat est inévitable lors du passage au socialisme, mais elle ne s’exerce pas par l’intermédiaire de l’organisation groupant tous les ouvriers de l’industrie. (…)
Il est impossible d’exercer la dictature du prolétariat par l’intermédiaire de l’organisation qui le groupe tout entier. Car ce n’est pas seulement chez nous, l’un des pays capitalistes les plus arriérés, mais aussi dans tous les autres pays capitalistes, que le prolétariat est encore si morcelé, humilié, corrompu çà et là (précisément par l’impérialisme dans certains pays) que que les ouvriers défendent leur Etat… »
A la conception du syndicat que Trotsky défendait à ce moment-là, à savoir le concept du syndicat appareil administratif et technique chargé de gérer la production, Lénine oppose le principe suivant :
« Les syndicats sont une école : école d’union, école de solidarité, école de défense des intérêts, école de gestion de l’économie, école d’administration » c’est-à-dire « une école du communisme et de la révolution » [49]
Selon Alfred Rosmer, syndicaliste-révolutionnaire gagné au communisme qui séjourna à Moscou ces années-là : « Trotsky, tenant compte de la justesse de certaines critiques contre son projet, le modifia, mais en s’élevant énergiquement contre ceux qui prétendaient y voir une militarisation des syndicats » [50]
Lénine, déjà rattrapé par la maladie qui va l’emporter, voit le danger bureaucratique qui menace la jeune Etat ouvrier, à la fin de la guerre civile. Son intervention dans la discussion sur les syndicats est le prélude à son dernier combat : le combat antibureaucratique qui le conduira à rompre toute relation avec Staline et à former un bloc avec Trotsky, dès que Staline, se comportant en argousin grand-Russe va s’en prendre aux communistes Georgiens.
1923 : Trotsky en faveur de « l’autonomie réelle, vitale, des syndicats »
Dans une adresse aux syndicalistes-communistes (ainsi appelait-on alors les syndicalistes-révolutionnaires qui, à l’instar de Rosmer et Monatte, avait adhéré au Parti communiste), Léon Trotsky explique :
« C’est précisément l’Internationale Communiste qui a mené une lutte acharnée contre la scission du mouvement syndical [en décembre 1921, s’est produit la première scission syndicale en France qui donne naissance à la CGTU (Confédération Générale du Travail Unitaire) séparée de la CGT la CGTU est animée par les militants communistes et anarchistes NDLR], c’est-à-dire contre sa transformation effective en partis syndicaux. C’est précisément l’Internationale Communiste qui a mis au premier rang les objectifs historique de la classe ouvrière elle-même et l’immense importance intrinsèque de l’organisation syndicale au point de vue de ces objectifs. Dans ce sens, dès le premier jour, l’Internationale Communiste a soutenu l’autonomie réelle, vitale des syndicats conformément à tout l’esprit du marxisme .
Le syndicalisme révolutionnaire qui, sous beaucoup de rapports, a été en France le précurseur du communisme contemporain, s’est borné à la théorie de la minorité d’initiative, autrement dit du parti, sans se transformer ouvertement en parti. Mais, par là-même, il a empêché les syndicats de se transformer en organisation, sinon de « la classe ouvrière elle-même » (ce qui est impossible en régime capitaliste), du moins de masses importantes de la classe ouvrière. Les communistes n’ont pas peur du nom de parti, parce que leur parti n’a rien de commun avec les autres partis. Ce n’est pas un des partis politiques du régime bourgeois, mais la minorité consciente, la minorité d’initiative de la classe ouvrière, son avant-garde révolutionnaire. C’est précisément pour cela que les communistes ne se couvrent pas dans le domaine de l’idéologie non plus que dans celui de l’organisation de l’organisation syndicale, n’exploitent pas cette dernière dans des manœuvres de coulisse, ne la divisent pas quand ils sont en minorité, ne gênent en rien son développement autonome, et l’aident de toutes leurs forces dans sa lutte. En même temps, le parti communiste se réserve le droit de se prononcer sur toutes les questions du mouvement ouvrier, de critiquer la tactique syndicale et d’apporter ses propositions que l’organisation syndicale est libre d’accepter ou de refuser. Le Parti s’efforce par l’action pratique de gagner la confiance de la classe, et avant tout sa partie syndiquée » [51].
Ce passage est un authentique plaidoyer en faveur de l’indépendance du syndicat vis-à-vis y compris du parti communiste ou… anticapitaliste.
Qu’on en juge :
« Marx écrivait, en effet, en 1868, que le parti ouvrier surgirait des syndicats. Mais il avait en vue principalement l’Angleterre qui était, en ce temps-là, le seul pays possédant un capitalisme développé et des organisations ouvrières importantes. Depuis lors, il s’est écoulé un demi-siècle. L’histoire, dans son ensemble, a confirmé son pronostic en ce qui concerne l’Angleterre. (…)
Marx n’a pas donné et ne pouvait donner de réponse universelle à la question de la nature des rapports organiques entre le parti et les syndicats. Quels doivent être ces rapports, cela dépend de facteurs et de circonstances différents. Qu’il existe une représentation réciproque du parti et de la confédération, ou que ces organisations constituent au fur et à mesure du besoin des comités d’action, c’est là une question qui n’a pas une importance essentielle. Les formes d’organisations peuvent varier mais le rôle fondamental du Parti reste immuable » [52]
1938 : les syndicats à l’époque de transition
Mais nos détracteurs affirment de leur côté qu’il y a opposition de principe entre la Charte d’Amiens et le marxisme. Pour étayer ce point de vue, ils citent les extraits d’un texte de Trotsky de 1929 « syndicalisme et communisme ». Or, dans ce même texte de Trotsky, nous lisons
« Le syndicalisme français d’avant-guerre, à ses débuts et pendant sa croissance, en combattant pour l’autonomie syndicale, combattit réellement pour son indépendance vis-à-vis du gouvernement bourgeois et de ses partis, parmi lesquels celui du socialisme réformiste et parlementaire. C’était une lutte contre l’opportunisme, par une voie révolutionnaire.
Le syndicalisme révolutionnaire n’a pas à cet égard fétichisé l’autonomie des organisations de masse. Bien au contraire, il a compris et a affirmé le rôle dirigeant de la minorité révolutionnaire dans les organisations de masse, organisations qui reflètent la classe ouvrière avec toutes ses contradictions, ses retards et ses faiblesses.
La théorie de la minorité active était essentiellement une théorie inachevée du parti prolétarien. Dans sa pratique, le syndicalisme révolutionnaire était l’embryon d’un parti révolutionnaire contre l’opportunisme, c’était une remarquable esquisse du communisme révolutionnaire. [53]
Autre passage de ce même texte :
La tâche bien comprise du Parti communiste ne consiste pas seulement à gagner en influence sur les syndicats, tels qu’ils sont, mais à gagner, par le biais des syndicats, une influence sur la majorité de la classe ouvrière. Ce n’est possible que si les méthodes utilisées par le parti dans les syndicats correspondent à la nature et aux tâches de ces derniers. La lutte d’influence du parti dans les syndicats se vérifie objectivement dans le fait qu’ils prospèrent ou pas, qu’ils augmentent le nombre de leurs syndiqués et au-delà leurs relations avec les masses les plus larges. Si le parti paie le prix de son influence dans les syndicats par leur amoindrissement et par le dernier des fractionnismes convertissant les syndicats en auxiliaires du parti pour des objectifs ponctuels et les empêchant de devenir des organisations de masse les relations entre le parti et la classe sont erronées . »
Difficile d’être plus clair…
Mais le document le plus achevé sur la question syndicale émanant de Trotsky reste, à nos yeux, le passage du programme de transition sur les syndicats à l’époque de transition :
Dans la lutte pour les revendications partielles et transitoires, les ouvriers ont actuellement plus besoin que jamais d’organisations de masse, avant tout de syndicats. La puissante montée des syndicats en France et aux États-Unis est la meilleure réponse aux doctrinaires ultra-gauches de la passivité qui prêchaient que les syndicats "avaient fait leur temps".
Les bolcheviks-léninistes se trouvent aux premiers rangs de toutes les formes de lutte, même là où il s’agit seulement des intérêts matériels ou des droits démocratiques les plus modestes de la classe ouvrière. Ils prennent une part active à la vie des syndicats de masse, se préoccupent de les renforcer et d’accroître leur esprit de lutte. Ils luttent implacablement contre toutes les tentatives de soumettre les syndicats à l’État bourgeois et de lier le prolétariat par "l’arbitrage obligatoire" et toutes les autres formes d’intervention policière, non seulement fascistes, mais aussi "démocratiques". C’est seulement sur la base de ce travail, qu’il est possible de lutter avec succès à l’intérieur des syndicats contre la bureaucratie réformiste, et en particulier contre la bureaucratie stalinienne. Les tentatives sectaires d’édifier ou de maintenir des petits syndicats "révolutionnaires" comme une seconde édition du parti signifient, en fait, le renoncement à la lutte pour la direction de la classe ouvrière. Il faut poser ici comme un principe inébranlable : l’auto-isolement capitulard hors des syndicats de masses, équivalant à la trahison de la révolution, est incompatible, avec l’appartenance à la IV° Internationale.
En même temps, la IV° Internationale rejette et condamne résolument tout fétichisme syndical, également propre aux trade-unionistes et aux syndicalistes :
a) Les syndicats n’ont pas et, vu leurs tâches, leur composition et le caractère de leur recrutement, ne peuvent avoir de programme révolutionnaire achevé ; c’est pourquoi ils ne peuvent remplacer le parti. L’édification de partis révolutionnaires nationaux, sections de la IV° Internationale, est la tâche centrale de l’époque de transition.
b) Les syndicats, même les plus puissants, n’embrassent pas plus de 20 à 25 % de la classe ouvrière et, d’ailleurs, ses couches les plus qualifiées et les mieux payées. La majorité la plus opprimée de la classe ouvrière n’est entraînée dans la lutte qu’épisodiquement, dans les périodes d’essor exceptionnel du mouvement ouvrier. A ces moments-là, il est nécessaire de créer des organisations ad hoc, qui embrassent toute la masse en lutte : les COMITÉS DE GREVE, les COMITÉS D’USINES, et, enfin, les SOVIETS.
c) En tant qu’organisation des couches supérieures du prolétariat, les syndicats, comme en témoigne toute l’expérience historique, y compris l’expérience toute fraîche des syndicats anarcho-syndicalistes d’Espagne, développent de puissantes tendances à la conciliation avec le régime démocratique bourgeois. Dans les périodes de luttes de classes aiguës, les appareils dirigeants des syndicats s’efforcent de se rendre maîtres du mouvement des masses pour le neutraliser. Cela se produit déjà lors de simples grèves, surtout lors des grèves de masse avec occupation des usines, qui ébranlent les principes de la propriété bourgeoise. En temps de guerre ou de révolution, quand la situation de la bourgeoisie devient particulièrement difficile, les dirigeants syndicaux deviennent ordinairement des ministres bourgeois.
C’est pourquoi les sections de la IV° Internationale doivent constamment s’efforcer, non seulement de renouveler l’appareil des syndicats, en proposant hardiment et résolument dans les moments critiques de nouveaux leaders prêts à la lutte à la place des fonctionnaires routiniers et des carriéristes, mais encore de créer, dans tous les cas où c’est possible, des organisations de combat autonomes qui répondent mieux aux tâches de la lutte des masses contre la société bourgeoise, sans même s’arrêter, si c’est nécessaire, devant une rupture ouverte avec l’appareil conservateur des syndicats. S’il est criminel de tourner le dos aux organisations de masse pour se contenter de fictions sectaires, il n’est pas moins criminel de tolérer passivement la subordination du mouvement révolutionnaire des masses au contrôle de cliques bureaucratiques ouvertement réactionnaires ou conservatrices masquées ("progressistes"). Le syndicat n’est pas une fin en soi, mais seulement un des moyens dans la marche à la révolution prolétarienne
[54]
Pour les fondateurs de la Quatrième internationale, c’est seulement sur la base du combat pour l’indépendance des syndicats qu’il est possible de lutter avec l’efficacité nécessaire contre leurs directions corrompues.
Nos anti-Charte nous diront alors qu’il s’agit là de l’indépendance à l’égard de l’Etat et du patronat et non vis-à-vis du parti révolutionnaire de la quatrième internationale ou du NPA. Mais si l’indépendance vis-à-vis du Parti n’est pas garantie, le syndicat cesse alors d’être un syndicat et devient « une seconde édition à peine augmentée du Parti », c’est le syndicat « RRRévolutionnaire » qui n’en est pas un, à côté duquel le syndicat dominé par les contre-révolutionnaires portant le masque de la « neutralité », continuera à vivre, dans la soumission à l’Etat impérialiste. Un petit syndicat indépendant d’avant-garde ne servirait effectivement à rien : la classe ouvrière a besoin de l’unité de ses rangs, elle la recherche dans le syndicat qui est sa base d’existence comme classe séparée du capital, le moyen qu’elle s’est donnée en vue de surmonter la concurrence entre salariés et d’obtenir droits, garanties collectives, lois protectrices . La garantie de cette unité, c’est l’indépendance la plus complète, y compris vis-à-vis du parti qui représente l’intérêt historique (le syndicat représentant l’intérêt immédiat) du prolétariat dans sa totalité. Est-ce à dire que ce Parti, qui n’existe pas encore, doit renoncer à prendre la direction du syndicat ? Absolument pas : le syndicat doit nécessairement être dirigé par les militants qui sont les garants de son indépendance et donc par les partisans de la rupture avec la bourgeoisie puisque tel est le contenu de l’indépendance des syndicats. Mais direction, au sens marxiste du terme, ne veut pas dire se subordonner, soumettre ou exercer une tutelle bureaucratique, cela veut dire au contraire : aider, conseiller, instruire, éclairer, dans le respect des formes de la démocratie au sein d’un syndicat, de l’autonomie fédérative de ses structures. D’ailleurs comment une direction antibureaucratique pourrait-elle aliéner la libre administration de toutes les strates de la confédération syndicale ? Alors oui, nous sommes d’accord pour dire, comme Trotsky que sans la direction politique d’un courant anticapitaliste, antibureaucratique et internationaliste, l’indépendance syndicale est impossible. En d’autres termes, nos détracteurs anti-Charte devraient méditer sur le fait que les révolutionnaires sont, et eux seuls, les garants de l’indépendance syndicale dans le même temps où ils doivent lutter pour prendre des positions les plus importantes, les plus élevées possibles dans les syndicats.
Ajoutons que le mot d’ordre d’indépendance syndicale est un mot d’ordre transitoire dont le contenu est anticapitaliste puisque, avons-nous dit, il recouvre le mot d’ordre de rupture avec la bourgeoisie.
Pour conclure (provisoirement)
Nos amis préviennent : « Refuser par principe d’organiser des fractions dans le mouvement syndical revient à renoncer à s’affronter aux directions syndicales, à l’heure où celles-ci collaborent comme jamais avec le Capital. ». Soit. Mais, encore une fois, la Charte d’Amiens n’a jamais interdit les fractions. Ce n’était pas son objet. Ou alors ils confondent peut-être avec le préambule des statuts de la CGT réunifiée en 1936 qui stipule : « La liberté d’opinion et le jeu de la démocratie, prévus et assurés par les principes fondamentaux du syndicalisme, ne sauraient justifier ni tolérer la constitution de fractions dans le but d’influencer et de fausser le jeu normal de la démocratie dans leur sein » [55] Mais ça, ça s’appelle, en 1936, le poison du stalinisme.
La Charte d’Amiens avait, dès le départ, écarté les formules coercitives de la motion réformiste des dirigeants du Livre « bannissant » toute discussion politique, tout rapport avec des partis, toute action antiparlementaire. La Charte « se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors » pour les raisons indiquées plus haut : ne pas transformer le syndicat en un cénacle déconnecté de la défense des intérêts immédiats, catégoriels et professionnels, corporatifs et interprofessionnels comme base de départ de tout élaboration politique, au sens large du mot ( « au sens syndical du terme » dit-on parfois) et de toute prise de position sur un problème de société ou institutionnel affectant l’action syndicale.
Bien entendu, la Charte d’Amiens ne saurait être un fétiche et encore moins l’un de ceux que l’on agite les jours de fête pour mieux se compromettre le lendemain dans des rapports de dépendance et de compromission avec des patrons, des ministres.
Parce que c’est un document fondé sur la reconnaissance de la lutte des classes, parce que c’est un document qui préconise la disparition du patronat et du salariat et l’expropriation des capitalistes, parce qu’il revendique l’indépendance du syndicat, l’indépendance réciproque partis-syndicats, il fait partie inconditionnellement de notre patrimoine de classe. C’est pourquoi il faut le défendre bec et ongles.
Le 2 novembre 2010
Pedro Carrasquedo (NPA 64)
Daniel Petri (NPA 94)
[1] Lettre à E. Bernstein. Friedrich Engels. 2 novembre 1882
[2] Léon Trotsky. Œuvres. Tome 2. La construction de la nouvelle internationale et la politique de front unique. 24 août 1933. Page 126. EDI 1978
[3] La grève générale en France. Robert Brécy. Page 37. EDI 1969
[4] Marx/Engels et la Troisième république. Lettre d’Engels du 14 avril 1893.Page 319. Editions sociales-1983
[5] .Voir : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 37. EDI 1969
[6] »Marx/Engels et la Troisième république. Lettre d’Engels du 14 mars 1892.Page 292. Editions sociales-1983
[7] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 38. EDI 1969
[8] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 43. EDI 1969
[9] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 43. EDI 1969
[10] [[Cité dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 142. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[11] Cité dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 149. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[12] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 34. Armand Colin. 1967
[13] Cité dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 149. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[14] Rosa Luxemburg : Œuvre I. (Réforme sociale ou Révolution ? Grèves de masse, parti et syndicats). Page 93. Petite Collection Maspero 1976
[15] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 48. EDI 1969
[16] Rosa Luxemburg : Œuvre I. (Réforme sociale ou Révolution ? Grèves de masse, parti et syndicats). Page 128. Petite Collection Maspero 1976
[17] Chiffres communiqués dans : Histoire du mouvement ouvrier 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 30. Armand Colin. 1967
[18] Cité dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 150. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[19] Marx/Engels et la Troisième république. Lettre d’Engels du 16 avril 1890.Page 245. Editions sociales-1983
[20] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 34. EDI 1969
[21] Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 36. Armand Colin. 1967
[22] Cité dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 44. EDI 1969
[23] Chiffres extraits de : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 182. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[24] Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 186. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[25] Cité dans http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Waldeck-Rousseau#cite_note-0
[26] Cité dans : Le mouvement socialiste sous la troisième république. Georges Lefranc. Page 106. Payot. 1963
[27] Cité dans : Le mouvement socialiste sous la troisième république. Georges Lefranc. Page 109. Payot. 1963
[28] Cité dans : Le mouvement socialiste sous la troisième république. Georges Lefranc. Page 60. Payot. 1963 et dans : La grève générale en France. Robert Brécy. Page 44. EDI 1969
[29] Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 27. Armand Colin. 1967
[30] L’introuvable démocratie salariale Le droit de la représentation du personnel dans l’entreprise (1890-2002). JP Le Crom hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/.../L_introuvable_democratie_salari.pd. Page 10
[31] L’introuvable démocratie salariale Le droit de la représentation du personnel dans l’entreprise (1890-2002). JP Le Crom hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/.../L_introuvable_democratie_salari.pd. Page 11
[32] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 26. Armand Colin. 1967
[33] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 28. Armand Colin. 1967
[34] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 28. Armand Colin. 1967
[35] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 29. Armand Colin. 1967
[36] Cité dans : Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 29. Armand Colin. 1967
[37] Le mouvement socialiste sous la troisième république. Georges Lefranc. Page 60. Payot. 1963
[38] Statuts de la Confédération générale du travail. Votés au Congrès de Montpellier. Lors de la discussion sur l’unité ouvrière / Confédération générale du travail. XIII ème congrès national corporatif. Compte-rendu officiel des travaux du congrès. Page 287. Fac-similé PDF mis en ligne par l’IHS.CGT http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_09_-_1902_-_Congres_Montpellier.pdf
[39] Chiffres extraits de : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 159. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[40] Histoire du mouvement ouvrier ** 1871-1920. Edouard Dolléans. Page 135. Armand Colin. 1967
[41] Charte d’Amiens, « indépendance syndicale » : Peut-on s’en réclamer ?
[42] Compte-rendu sténographique des débats du congrès de la CGT tenu à Amiens en 1906 (séances consacrées aux "Rapports entre les syndicats et les partis politiques") https://www.marxists.org/francais/cgt/works/1906/10/cgt_amiens.htm
[43] Reproduite en annexe dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 315. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970
[44] Compte-rendu sténographique des débats du congrès de la CGT tenu à Amiens en 1906 (séances consacrées aux "Rapports entre les syndicats et les partis politiques") mis en ligne sur : https://www.marxists.org/francais/cgt/works/1906/10/cgt_amiens.htm
[45] Les débats du congrès d’Amiens (1906). Séance du 12 octobre 1906 (soir) https://www.marxists.org/francais/cgt/works/1906/10/cgt_amiens2.htm
[46] Séance du 13 octobre (matin), du congrès d’Amiens (1906) de la CGT.
https://www.marxists.org/francais/cgt/works/1906/10/cgt_amiens3.htm
[47] Séance du 13 octobre (matin), du congrès d’Amiens (1906) de la CGT.https://www.marxists.org/francais/cgt/works/1906/10/cgt_190610000.htm
[48] Léon Trotsky. Le Mouvement communiste en France. Pour le 2 ème Congrès mondial. 22 juillet 1920 (La Pravda). Page 75. Editions de minuit. 1967
[49] Voir : V. Lénine. Œuvres. Tome 32 ; Décembre 1920-août 1921. Editions sociales*Paris / Editions du Progrès*Moscou. 1977. Extraits du discours du 30/12/1920 (Page 11) et de la brochure (page 67) du 25/01/1921
[50] Alfred Rosmer. Moscou sous Lénine II. 1921-1924. Page 10.Petite collection Maspero. 1970
[51] Léon Trotsky. Le Mouvement communiste en France. Une explication nécessaire avec les syndicalistes-révolutionnaires. 21 mars 1923. Page 265. Editions de minuit. 1967
[52] Léon Trotsky. Le Mouvement communiste en France. Une explication nécessaire avec les syndicalistes-révolutionnaires. 21 mars 1923. Page 264-265. Editions de minuit. 1967.
[53] Œuvres - Léon Trotsky. Syndicalisme et communisme 14 octobre 1929. MIA http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1929/10/lt19291014a.htm
[54] http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran5.html
[55] Cité dans : Les syndicats en France. Jean-Daniel Reynaud. Tome 2 ; page 49 ; éditions du seuil. 1975
 Urgence, pouvoir d’achat et grève générale
Urgence, pouvoir d’achat et grève généraleAlors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux...
 « Ces gens-là »
« Ces gens-là »La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”....
 Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !
Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la...
 Répression, maître-mot de la macronie.
Répression, maître-mot de la macronie.La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes...
 Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !
Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...
 Alain Krivine
Alain KrivineLa Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa...